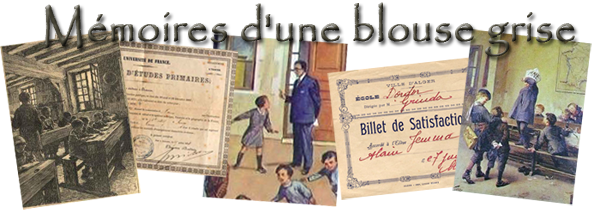jeudi 30 avril 2009
Pourquoi ce titre
Ce titre s’est imposé, suite à une suggestion émise par un très bon copain d’école Jacques Vandeville, avec qui j’avais fait, presque toute ma scolarité primaire.
J’ai lu et conservé des articles du « Courrier des lecteurs » parus dans notre quotidien régional « Le Courrier Picard ». Un article de Monsieur Jacques Dheilly laissait apparaître une certaine nostalgie de l’Ecole Primaire.
Nostalgie « positive » En effet, on se souvient, en général, plus facilement, des bons moments, mais rarement des fichus quarts d’heures.
Je ne critique pas cette façon de penser, mais j’y ajoute d’autres souvenirs bons ou moins bons, pour ne pas dire mauvais.
Bonne lecture de mes mémoires d'une blouse grise...
mercredi 29 avril 2009
Mes souvenirs...
Mes souvenirs ne remontent, guère, qu’à l’année 1939, à l’époque de la déclaration de la guerre des Alliés à l’Allemagne Nazie.
Les habitants s’étaient regroupés devant les affiches apposées sur les murs de l’école Cagnard et à la lecture de celles-ci, des femmes pleuraient. C’est un mauvais souvenir.
Je me souviens, un peu de notre dernière année de maternelle, mais c’est très flou, nous nous rendions, à l’école, chacun avec un masque à gaz. Les enfants, comme les adultes, étaient tenus à avoir un masque à gaz à portée de la main. Ceux pour adultes étaient en toile imperméabilisée et ceux pour nous, les gosses, étaient en caoutchouc. Sa boite, en métal, pour le transporter était assez haute et lourde. Ma mère, couturière, m’avait confectionné un sac de toile, genre musette, plus léger et plus pratique pour porter ce masque en bandoulière.
Les parents ou autres accompagnateurs d’enfants en bas âge, portaient le masque, en même temps que le leur, mais dans la cour de récréation, les enfants devaient avoir leur masque à portée de la main.
Ce masque, je l’ai gardé, bien longtemps après la guerre, je l’avais trafiqué pour en faire un « tuba ». Dans le canal de la Somme, lors de baignades, j’ai bien souvent bu la « tasse » avec ce masque trafiqué.
A l’exode, nous sommes partis, le 19 Mai 1940, le long du canal de la Somme en suivant le fleuve jusqu’à Ailly sur Somme, En se retournant, on voyait le ciel rougeoyant au dessus d’Amiens en feu. Puis nous nous sommes arrêtés de nombreux jours, à Saint Sauveur avant de fuir vers Bertangles, puis vers Talmas où nous avons séjourné le reste de l’exode, jusqu’à notre retour vers Amiens.
Je repris en école primaire, en classe de préparatoire avec Mademoiselle Devillers dans le courant de la scolarité de 1939/ 1940, mais à quel moment je ne saurais le dire. Est-ce au mois d’octobre ou plus tard ?
L’année suivante, la reconstruction de la partie ouest de l’école, démolie par les bombardements de 1940 nous obligea à déménager pendant les travaux au cours de la scolarité de 1941/1942, c’est à dire la troisième classe au fond du couloir, du premier étage, le cours élémentaire de première année avec Madame Humez.
Le mur, séparant la cour de l’école et la cour du patronage catholique, fut percé au milieu des urinoirs pour y installer une porte provisoire. Cette porte, nous l’empruntions pour nous rendre en classe dans une pièce-vestiaire de la salle paroissiale. Et cela a duré un long moment, le temps que l’aile ouest de l’école soit reconstruite.
A Saint Maurice, avec l’afflux des sinistrés des quartiers Saint Jacques, Saint Leu, et Saint Germain, ainsi que le retour d’exode de la population, il fallut construire , à partir de 1941, des cités d’urgence, avec des matériaux de récupération des démolitions engendrées par les bombardements et les tirs d’artillerie Allemands, de Mai 1940.
Sur la place du quartier, en haut de la rue de la Falaise et sur le stade de Saint Maurice, maintenant sur tout l’emplacement de la Résidence « La Pépinière », il fut construit « l’Ilot de Saint Maurice » avec des briques de récupération, enduites de ciment.
Les habitants s’étaient regroupés devant les affiches apposées sur les murs de l’école Cagnard et à la lecture de celles-ci, des femmes pleuraient. C’est un mauvais souvenir.
Je me souviens, un peu de notre dernière année de maternelle, mais c’est très flou, nous nous rendions, à l’école, chacun avec un masque à gaz. Les enfants, comme les adultes, étaient tenus à avoir un masque à gaz à portée de la main. Ceux pour adultes étaient en toile imperméabilisée et ceux pour nous, les gosses, étaient en caoutchouc. Sa boite, en métal, pour le transporter était assez haute et lourde. Ma mère, couturière, m’avait confectionné un sac de toile, genre musette, plus léger et plus pratique pour porter ce masque en bandoulière.
Les parents ou autres accompagnateurs d’enfants en bas âge, portaient le masque, en même temps que le leur, mais dans la cour de récréation, les enfants devaient avoir leur masque à portée de la main.
Ce masque, je l’ai gardé, bien longtemps après la guerre, je l’avais trafiqué pour en faire un « tuba ». Dans le canal de la Somme, lors de baignades, j’ai bien souvent bu la « tasse » avec ce masque trafiqué.
A l’exode, nous sommes partis, le 19 Mai 1940, le long du canal de la Somme en suivant le fleuve jusqu’à Ailly sur Somme, En se retournant, on voyait le ciel rougeoyant au dessus d’Amiens en feu. Puis nous nous sommes arrêtés de nombreux jours, à Saint Sauveur avant de fuir vers Bertangles, puis vers Talmas où nous avons séjourné le reste de l’exode, jusqu’à notre retour vers Amiens.
Je repris en école primaire, en classe de préparatoire avec Mademoiselle Devillers dans le courant de la scolarité de 1939/ 1940, mais à quel moment je ne saurais le dire. Est-ce au mois d’octobre ou plus tard ?
L’année suivante, la reconstruction de la partie ouest de l’école, démolie par les bombardements de 1940 nous obligea à déménager pendant les travaux au cours de la scolarité de 1941/1942, c’est à dire la troisième classe au fond du couloir, du premier étage, le cours élémentaire de première année avec Madame Humez.
Le mur, séparant la cour de l’école et la cour du patronage catholique, fut percé au milieu des urinoirs pour y installer une porte provisoire. Cette porte, nous l’empruntions pour nous rendre en classe dans une pièce-vestiaire de la salle paroissiale. Et cela a duré un long moment, le temps que l’aile ouest de l’école soit reconstruite.
A Saint Maurice, avec l’afflux des sinistrés des quartiers Saint Jacques, Saint Leu, et Saint Germain, ainsi que le retour d’exode de la population, il fallut construire , à partir de 1941, des cités d’urgence, avec des matériaux de récupération des démolitions engendrées par les bombardements et les tirs d’artillerie Allemands, de Mai 1940.
Sur la place du quartier, en haut de la rue de la Falaise et sur le stade de Saint Maurice, maintenant sur tout l’emplacement de la Résidence « La Pépinière », il fut construit « l’Ilot de Saint Maurice » avec des briques de récupération, enduites de ciment.
mardi 28 avril 2009
Les mêmes maisons
Les mêmes maisons furent construites, sur le terre-plein de la rue Jean Jaurés, à la Hotoie, ainsi que sur la partie comprise entre le boulevard Faidherbe et le boulevard Garibaldi, à l’emplacement du grand parking actuel.
Dans un champ, dans la partie comprise entre la rue Emile Lesot et le Chemin de la Folie (aujourd’hui la rue de l’Abbé Hénocque), on construisit une cité en planches, peintes au Carbonyl, d’où son surnom de Village Noir.
Beaucoup plus tard, après la Libération de la France par les Alliés, vers 1945 ou 1946, les Etats Unis ont fourni des maisons, préfabriquées, en « kit » Elles furent installées sur les emplacements actuels du Foyer de l’Enfance et du parking de l’hôpital Nord de chaque côté de la rue Zamenhoff. Deux rues y furent créées, rue Gérard Magnier et rue Robert Maréchal. Ils étaient tous deux résistants, contre l’occupant Allemand, au cours de la dernière guerre, le premier cité est mort en déportation et le second fut fusillé, fin août 1944, juste avant la Libération d’Amiens. Les deux rues citées ci- dessus, sont, maintenant totalement, disparues
Dans le préau de l’école Zamenhoff, il fut créé deux nouvelles salles de classe supplémentaires, pour faire face à l’afflux d’enfants des cités d’urgence. Le bureau de vote, dans lequel nous votons, est l’une des salles, avec celle de droite, qui furent installées dans ce préau.
On avait atteint un total de 10 classes dans l’école Zamenhoff et il avait, également 10 classes dans l’école des filles rue Cagnard. A l’époque, il n’y avait pas encore la mixité.
Ces classes, nouvellement créées, furent dirigées entre-autres par Messieurs Joly Ernest, Demolliens, Poignant, il y en eut, certainement d’autres mais je ne m’en rappelle plus.
Ce fut dans cette période que fut creusé un abri-souterrain dans la cour. Nous allions nous ébattre pendant les récréations dans la cour du patronage catholique, aujourd’hui à l’emplacement des bâtiments des Télécoms.
Une partie de nos scolarités de 1943 et 1944 se passa dans cet abri de secours pendant les attaques aériennes et les bombardements, c’était un moment privilégié pour apprendre nos leçons ou nos récitations.
Tous les élèves ne descendaient pas dans l’abri, pendant les alertes, des parents n’acceptant pas que leurs enfants descendent dans les abris, le danger était partout le même, ces élèves étaient regroupés dans une seule classe en attendant la fin de l’alerte. J’étais parmi ceux-ci. Nous n’étions pas conscients du danger, s’il y en avait un. Et c’était plus facile pour apprendre nos leçons ou récitations, plutôt que dans cet abri inconfortable, à la lumière incertaine de quelques ampoules électriques.
Par ailleurs, juste devant l’école primaire, plusieurs maisons, entre les numéros 3 et 15 de la rue Saint Maurice, furent bombardées et démolies en 1940. Complètement rasées, les décombres enlevés, il ne restait plus que les caves voûtées, en briques, encore accessibles par des escaliers, eux aussi, en briques. Beaucoup de riverains y jetaient toutes sortes de détritus.
En avance, avant la rentrée en classe, nous y jouions, dedans, au risque de s’y blesser, si les voûtes s’étaient écroulées.
Dans un champ, dans la partie comprise entre la rue Emile Lesot et le Chemin de la Folie (aujourd’hui la rue de l’Abbé Hénocque), on construisit une cité en planches, peintes au Carbonyl, d’où son surnom de Village Noir.
Beaucoup plus tard, après la Libération de la France par les Alliés, vers 1945 ou 1946, les Etats Unis ont fourni des maisons, préfabriquées, en « kit » Elles furent installées sur les emplacements actuels du Foyer de l’Enfance et du parking de l’hôpital Nord de chaque côté de la rue Zamenhoff. Deux rues y furent créées, rue Gérard Magnier et rue Robert Maréchal. Ils étaient tous deux résistants, contre l’occupant Allemand, au cours de la dernière guerre, le premier cité est mort en déportation et le second fut fusillé, fin août 1944, juste avant la Libération d’Amiens. Les deux rues citées ci- dessus, sont, maintenant totalement, disparues
Dans le préau de l’école Zamenhoff, il fut créé deux nouvelles salles de classe supplémentaires, pour faire face à l’afflux d’enfants des cités d’urgence. Le bureau de vote, dans lequel nous votons, est l’une des salles, avec celle de droite, qui furent installées dans ce préau.
On avait atteint un total de 10 classes dans l’école Zamenhoff et il avait, également 10 classes dans l’école des filles rue Cagnard. A l’époque, il n’y avait pas encore la mixité.
Ces classes, nouvellement créées, furent dirigées entre-autres par Messieurs Joly Ernest, Demolliens, Poignant, il y en eut, certainement d’autres mais je ne m’en rappelle plus.
Ce fut dans cette période que fut creusé un abri-souterrain dans la cour. Nous allions nous ébattre pendant les récréations dans la cour du patronage catholique, aujourd’hui à l’emplacement des bâtiments des Télécoms.
Une partie de nos scolarités de 1943 et 1944 se passa dans cet abri de secours pendant les attaques aériennes et les bombardements, c’était un moment privilégié pour apprendre nos leçons ou nos récitations.
Tous les élèves ne descendaient pas dans l’abri, pendant les alertes, des parents n’acceptant pas que leurs enfants descendent dans les abris, le danger était partout le même, ces élèves étaient regroupés dans une seule classe en attendant la fin de l’alerte. J’étais parmi ceux-ci. Nous n’étions pas conscients du danger, s’il y en avait un. Et c’était plus facile pour apprendre nos leçons ou récitations, plutôt que dans cet abri inconfortable, à la lumière incertaine de quelques ampoules électriques.
Par ailleurs, juste devant l’école primaire, plusieurs maisons, entre les numéros 3 et 15 de la rue Saint Maurice, furent bombardées et démolies en 1940. Complètement rasées, les décombres enlevés, il ne restait plus que les caves voûtées, en briques, encore accessibles par des escaliers, eux aussi, en briques. Beaucoup de riverains y jetaient toutes sortes de détritus.
En avance, avant la rentrée en classe, nous y jouions, dedans, au risque de s’y blesser, si les voûtes s’étaient écroulées.
lundi 27 avril 2009
Entre 1940 et 1945
Pendant les années de 1940 à 1945, au moins, il était très difficile de se procurer des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures, des livres, des cahiers, etc.
La difficulté de se procurer des fournitures scolaires se ressentait, même, à l’école, surtout, pour les livres pédagogiques et les cahiers, il ne fallait rien gaspiller.
Pour recouvrir nos livres scolaires ou nos cahiers, il y avait une sorte de papier bleu, assez difficile à se procurer sur lequel nous marquions les en-têtes avec de l’eau de javel, d’autres récupéraient des fonds de papiers peints d’avant guerre pour les mêmes usages.
Mon père, maçon-cimentier, me récupérait les feuilles grises des sacs vides, de ciment.
En effet, les sacs de ciment se composaient de cinq ou six épaisseurs de papier assez fort, et les feuilles intérieures ( 2 ou 3 ) étaient propres et nous servaient pour recouvrir nos livres ou nos cahiers d’école. Avec la pénurie, nous nous devions d’y faire très attention.
De toutes façons nous étions tenus d’apporter le plus possible de papier pour que l’école puisse avoir, en échange, des livres scolaires aussi, nous n’avions pas beaucoup de livres neufs par an, Il n’était pas question d’en changer à chaque scolarité.
Je me souviens d’un très bon copain, Jacques Boulanger, que j’ai revu il y a quelques années, dont le père travaillait à l’Union des Peintres et qui amenait à l’école des monceaux de chutes de différents papiers peints.
Toujours dans le cadre de la pénurie de matériaux, métaux ou autres, il fallait récupérer les quelques cartons d’emballages, bouteilles vides, douilles d’ampoules, le cuivre, l’aluminium, les papiers, etc. Et ainsi avoir des tickets de rationnement pour tenter d’acheter, à nouveau, des produits ou des fournitures familiales ou autres choses, à condition d’en trouver dans les magasins,….peu fournis, peu approvisionnés.
Les classes étaient très chargées (35 à 40 élèves) mais les instituteurs, très rigoureux pour la discipline, avaient une tenue très stricte, une autorité naturelle et une prestance respectées par tous. Il n’y avait aucun laisser-aller.
Les parents d’élèves étaient, à de très rares exceptions, en parfait accord avec les instituteurs et institutrices, pour la discipline, le programme scolaire, les leçons à apprendre ou les devoirs à réaliser à la maison.
Par temps froid, dans la rue, nous portions tous un béret ou un passe-montagne, ou encore un grand cache-nez plié en deux et cousu sur une vingtaine de centimètres, celui-ci était enfilé comme un bonnet et les deux extrémités étaient nouées autour du cou.
Aux mains, des gants ou des moufles de laine, tricotés par la mère ou la grande sœur, très souvent avec de la laine détricotée d’un vieux pull-over. Rien ne se perdait. Certains enfilaient aux mains, des chaussettes. En ces moments là, les hivers étaient très rigoureux.
Toujours la pauvreté, la misère dans nos quartiers populaires.
On devait se découvrir en rencontrant une institutrice ou un instituteur ou encore au passage d’un convoi mortuaire. Et il y en avait bien souvent, se dirigeant vers la cimetière de La Madeleine. L’ordonnateur, à pieds, devant, le bicorne sur la tête, suivi du corbillard, tiré par des chevaux noirs puis par la famille et les amis. Si nous étions surpris le béret sur la tête, non découvert, le lendemain en classe, on avait droit à des remontrances et une punition écrite à faire un soir à l’école, en retenue, « collé » comme on disait.
Et ce n’était pas la peine d’aller se plaindre aux parents, l’instituteur avait toujours raison et nos parents abondaient dans son sens. Même après la sortie du primaire ou devenus jeunes adultes, nous restions très déférents envers nos anciens maîtres.
La difficulté de se procurer des fournitures scolaires se ressentait, même, à l’école, surtout, pour les livres pédagogiques et les cahiers, il ne fallait rien gaspiller.
Pour recouvrir nos livres scolaires ou nos cahiers, il y avait une sorte de papier bleu, assez difficile à se procurer sur lequel nous marquions les en-têtes avec de l’eau de javel, d’autres récupéraient des fonds de papiers peints d’avant guerre pour les mêmes usages.
Mon père, maçon-cimentier, me récupérait les feuilles grises des sacs vides, de ciment.
En effet, les sacs de ciment se composaient de cinq ou six épaisseurs de papier assez fort, et les feuilles intérieures ( 2 ou 3 ) étaient propres et nous servaient pour recouvrir nos livres ou nos cahiers d’école. Avec la pénurie, nous nous devions d’y faire très attention.
De toutes façons nous étions tenus d’apporter le plus possible de papier pour que l’école puisse avoir, en échange, des livres scolaires aussi, nous n’avions pas beaucoup de livres neufs par an, Il n’était pas question d’en changer à chaque scolarité.
Je me souviens d’un très bon copain, Jacques Boulanger, que j’ai revu il y a quelques années, dont le père travaillait à l’Union des Peintres et qui amenait à l’école des monceaux de chutes de différents papiers peints.
Toujours dans le cadre de la pénurie de matériaux, métaux ou autres, il fallait récupérer les quelques cartons d’emballages, bouteilles vides, douilles d’ampoules, le cuivre, l’aluminium, les papiers, etc. Et ainsi avoir des tickets de rationnement pour tenter d’acheter, à nouveau, des produits ou des fournitures familiales ou autres choses, à condition d’en trouver dans les magasins,….peu fournis, peu approvisionnés.
Les classes étaient très chargées (35 à 40 élèves) mais les instituteurs, très rigoureux pour la discipline, avaient une tenue très stricte, une autorité naturelle et une prestance respectées par tous. Il n’y avait aucun laisser-aller.
Les parents d’élèves étaient, à de très rares exceptions, en parfait accord avec les instituteurs et institutrices, pour la discipline, le programme scolaire, les leçons à apprendre ou les devoirs à réaliser à la maison.
Par temps froid, dans la rue, nous portions tous un béret ou un passe-montagne, ou encore un grand cache-nez plié en deux et cousu sur une vingtaine de centimètres, celui-ci était enfilé comme un bonnet et les deux extrémités étaient nouées autour du cou.
Aux mains, des gants ou des moufles de laine, tricotés par la mère ou la grande sœur, très souvent avec de la laine détricotée d’un vieux pull-over. Rien ne se perdait. Certains enfilaient aux mains, des chaussettes. En ces moments là, les hivers étaient très rigoureux.
Toujours la pauvreté, la misère dans nos quartiers populaires.
On devait se découvrir en rencontrant une institutrice ou un instituteur ou encore au passage d’un convoi mortuaire. Et il y en avait bien souvent, se dirigeant vers la cimetière de La Madeleine. L’ordonnateur, à pieds, devant, le bicorne sur la tête, suivi du corbillard, tiré par des chevaux noirs puis par la famille et les amis. Si nous étions surpris le béret sur la tête, non découvert, le lendemain en classe, on avait droit à des remontrances et une punition écrite à faire un soir à l’école, en retenue, « collé » comme on disait.
Et ce n’était pas la peine d’aller se plaindre aux parents, l’instituteur avait toujours raison et nos parents abondaient dans son sens. Même après la sortie du primaire ou devenus jeunes adultes, nous restions très déférents envers nos anciens maîtres.
dimanche 26 avril 2009
Beaucoup d’enfants
Beaucoup d’enfants, dans nos quartiers populaires étaient habillés avec des vêtements, retouchés du grand frère. D’autres avec des vêtements cousus par la mère (ce fut mon cas) ou par une voisine. Ces tissus étaient récupérés sur de vieux vêtements pour en faire des « neufs ».
Que de souvenirs avec ces fameuses blouses grises, en fibres de bois, mélangées, avec quoi ? Mystère ! Raides au lavage ou quand elles étaient mouillées, rêches au toucher comme au porter, nous avions bien souvent des démangeaisons aux avant-bras, si nous ne replions pas un peu les manches de nos blouses.
Nous étions chaussés de toutes sortes de façons, de gros sabots de bois, parfois de grosses chaussures montantes (godillots) récupérées dans les greniers, ou encore de grosses chaussures montantes à semelles de bois, bardées de clous « caboche ». Ces semelles de bois absorbaient l’humidité de la pluie ou de la neige ou se fendaient en deux à l’usage. Mon père avait cloué de petites bandes de tôle (de boite de conserve) à chaque extrémité des semelles, pour éviter qu’elles ne se fendent. Certains parents avaient réussi à se procurer des bottes en caoutchouc synthétique. Où ? Encore un mystère !
On était loin des cartables, de trousses ou de protège-cahiers de grandes marques. Celles-ci n’existaient pas. On nous récupérait le vieux cartable du voisin ou du grand frère. Trousses toute simples, parfois cousues par la mère ou par le cordonnier du coin avec du cuir de récupération. Pour ma part j’avais toujours des trousses, en grosse toile, cousues par ma mère. Mais dans les toutes premières années de l’école primaire, nous avions tous le bon vieux plumier en bois qui faisait du bruit quand on le refermait, bien souvent par plaisir.
Bien après la guerre, l’été, beaucoup de jeunes portaient une forme de « chaussures » tout en caoutchouc, appelées « FIFI » Pourquoi ? Echauffement aux pieds garanti.
Que de souvenirs avec ces fameuses blouses grises, en fibres de bois, mélangées, avec quoi ? Mystère ! Raides au lavage ou quand elles étaient mouillées, rêches au toucher comme au porter, nous avions bien souvent des démangeaisons aux avant-bras, si nous ne replions pas un peu les manches de nos blouses.
Nous étions chaussés de toutes sortes de façons, de gros sabots de bois, parfois de grosses chaussures montantes (godillots) récupérées dans les greniers, ou encore de grosses chaussures montantes à semelles de bois, bardées de clous « caboche ». Ces semelles de bois absorbaient l’humidité de la pluie ou de la neige ou se fendaient en deux à l’usage. Mon père avait cloué de petites bandes de tôle (de boite de conserve) à chaque extrémité des semelles, pour éviter qu’elles ne se fendent. Certains parents avaient réussi à se procurer des bottes en caoutchouc synthétique. Où ? Encore un mystère !
On était loin des cartables, de trousses ou de protège-cahiers de grandes marques. Celles-ci n’existaient pas. On nous récupérait le vieux cartable du voisin ou du grand frère. Trousses toute simples, parfois cousues par la mère ou par le cordonnier du coin avec du cuir de récupération. Pour ma part j’avais toujours des trousses, en grosse toile, cousues par ma mère. Mais dans les toutes premières années de l’école primaire, nous avions tous le bon vieux plumier en bois qui faisait du bruit quand on le refermait, bien souvent par plaisir.
Bien après la guerre, l’été, beaucoup de jeunes portaient une forme de « chaussures » tout en caoutchouc, appelées « FIFI » Pourquoi ? Echauffement aux pieds garanti.
samedi 25 avril 2009
Nos galères !
Une cuillerée d’huile de foie de morue, ( que c’était dégueulasse ) tous les matins, pendant l’hiver et de ces pastilles roses de « vitamines » aussi tous les matins. Qu’est-ce que c’était ?
Que valaient-elles ? Nous ne l’avons jamais su !
Un livre de calcul ou de grammaire ou encore d’histoire ou de géographie, de sciences pour deux élèves pendant une demi-semaine chacun. Je me souviens, très vaguement, de brouillons écrits sur de vieilles enveloppes récupérées et ouvertes, pour écrire sur l’envers.
Rappelez vous ces fameux poêles « colonnes » Godin, que les élèves des classes de fin d’études primaires, devaient deux par deux, à tour de rôle, allumer avant l’arrivée des autres élèves dans les différentes classes.
Il fallait ramasser le papier jeté par les copains, ou en apporter, dans la mesure du possible, ainsi que du petit bois pour lancer le feu avant d’y mettre le charbon, que nous devions aller chercher dans la réserve au fond de la cour. Et le lendemain, il fallait nettoyer ces fameux poêles, vider les cendres de la veille, avant de l’allumer de nouveau.
Rappelez vous, ces urinoirs en plaques d’ardoises et ces waters, avec une porte basse, ouverts à tout vent. Aussi l’hiver nous n’y stationnions pas très longtemps. Quant au journal, tel que « Le Progrès de la Somme » vous vous doutez de l’usage que nous en faisions. Et ce n’était pas du « Moltonel » en trois épaisseurs.
Pendant la guerre, il y avait, déjà, le problème des poux et nous n’avions pas les produits de traitement, actuels, certainement plus efficaces. Aussi les têtes des gosses, les plus infestées, étaient saupoudrées de « Marie Rose » par les infirmières et les médecins visitant les écoles maternelles et primaires. Mais, nous avions tous, plus ou moins de poux.
Pour tous, c’était un vrai supplice de se faire gratter, fermement le crâne, par notre mère, avec un peigne à denture très fine, pour décrocher les larves de poux, appelées, Lentes
Heureusement, la plupart des enfants avaient les cheveux assez courts. Après deux ou trois séances de grattage, par semaine, nous avions la peau du crâne en « feu ».
Dans un quartier, pauvre, populaire tel celui de Saint Maurice, avec des familles nombreuses aux revenus très modestes, il était très onéreux pour certains d’aller chez le coiffeur. Aussi, un coiffeur, rétribué par la Ville d’Amiens, était chargé d’officier sur ces têtes de gosses. Le résultat n’était guère flatteur. « Boule à Zéro »
C’étaient les institutrices et les instituteurs qui désignaient les « suppliciés »
Et la revue des mains et des ongles. Suprême honte d’être obligé de se nettoyer les ongles devant les copains, et il y avait du monde qui n’avait pas eu recours aux soins maternels, alors c’était tout simplement… Nettoyage pour tous.
La destruction du pont Cagnard par les Allemands, le 31 août 1944, pour protéger leur fuite avait provoqué d’énormes dégâts aux écoles, maternelle et primaire, toutes proches.
Les filles de cette école primaire, venaient à l’école des garçons Zamenhof, soit le matin, soit l’après-midi ,6 jours sur 7, de 7 à 13 heures le matin, ou de 13 à 19 heures l’après-midi.
Il fallait apporter un casse-croûte pour collationner au cours d’une récréation.
Cette forme d’horaires pour les garçons et les filles dura plusieurs mois. Il inutile de dire qu’il ne fallait rien laisser dans les pupitres, tels livres, cahiers petites fournitures, etc. car le lendemain tout était disparu. Je reparlerais de cette période par la suite.
Après la guerre, les classes de fin d’études pour le fameux Certificat, étaient très dures car nous avions été perturbés dans nos scolarités à la suite des événements que l’on connaît.
Les programmes étaient très chargés et il fallait mettre les bouchées doubles.
Après les cérémonies, telles que les cérémonies du 11 novembre, foires-expositions, cirque ou cinéma pour les fêtes de fin d’année, dans les 2 ou 3 années avant le certificat d’études, nous avions le lendemain ou dans les jours suivants, une rédaction à rédiger sur le sujet.
Indépendamment du texte qu’il fallait imaginer, il ne fallait pas ou peu de fautes de Français ou d’accents dans la rédaction.
Un élève de ma scolarité de 1948/1949 Roger Marguillier, rédigeait des rédactions du tonnerre, de petits chefs d’œuvre. A chaque fois, l’instituteur lui demandait de nous lire à haute voix sa rédaction. J’avais une certaine admiration pour les textes de ce copain, car il avait un don de narration et d’écriture extraordinaires.
Que valaient-elles ? Nous ne l’avons jamais su !
Un livre de calcul ou de grammaire ou encore d’histoire ou de géographie, de sciences pour deux élèves pendant une demi-semaine chacun. Je me souviens, très vaguement, de brouillons écrits sur de vieilles enveloppes récupérées et ouvertes, pour écrire sur l’envers.
Rappelez vous ces fameux poêles « colonnes » Godin, que les élèves des classes de fin d’études primaires, devaient deux par deux, à tour de rôle, allumer avant l’arrivée des autres élèves dans les différentes classes.
Il fallait ramasser le papier jeté par les copains, ou en apporter, dans la mesure du possible, ainsi que du petit bois pour lancer le feu avant d’y mettre le charbon, que nous devions aller chercher dans la réserve au fond de la cour. Et le lendemain, il fallait nettoyer ces fameux poêles, vider les cendres de la veille, avant de l’allumer de nouveau.
Rappelez vous, ces urinoirs en plaques d’ardoises et ces waters, avec une porte basse, ouverts à tout vent. Aussi l’hiver nous n’y stationnions pas très longtemps. Quant au journal, tel que « Le Progrès de la Somme » vous vous doutez de l’usage que nous en faisions. Et ce n’était pas du « Moltonel » en trois épaisseurs.
Pendant la guerre, il y avait, déjà, le problème des poux et nous n’avions pas les produits de traitement, actuels, certainement plus efficaces. Aussi les têtes des gosses, les plus infestées, étaient saupoudrées de « Marie Rose » par les infirmières et les médecins visitant les écoles maternelles et primaires. Mais, nous avions tous, plus ou moins de poux.
Pour tous, c’était un vrai supplice de se faire gratter, fermement le crâne, par notre mère, avec un peigne à denture très fine, pour décrocher les larves de poux, appelées, Lentes
Heureusement, la plupart des enfants avaient les cheveux assez courts. Après deux ou trois séances de grattage, par semaine, nous avions la peau du crâne en « feu ».
Dans un quartier, pauvre, populaire tel celui de Saint Maurice, avec des familles nombreuses aux revenus très modestes, il était très onéreux pour certains d’aller chez le coiffeur. Aussi, un coiffeur, rétribué par la Ville d’Amiens, était chargé d’officier sur ces têtes de gosses. Le résultat n’était guère flatteur. « Boule à Zéro »
C’étaient les institutrices et les instituteurs qui désignaient les « suppliciés »
Et la revue des mains et des ongles. Suprême honte d’être obligé de se nettoyer les ongles devant les copains, et il y avait du monde qui n’avait pas eu recours aux soins maternels, alors c’était tout simplement… Nettoyage pour tous.
La destruction du pont Cagnard par les Allemands, le 31 août 1944, pour protéger leur fuite avait provoqué d’énormes dégâts aux écoles, maternelle et primaire, toutes proches.
Les filles de cette école primaire, venaient à l’école des garçons Zamenhof, soit le matin, soit l’après-midi ,6 jours sur 7, de 7 à 13 heures le matin, ou de 13 à 19 heures l’après-midi.
Il fallait apporter un casse-croûte pour collationner au cours d’une récréation.
Cette forme d’horaires pour les garçons et les filles dura plusieurs mois. Il inutile de dire qu’il ne fallait rien laisser dans les pupitres, tels livres, cahiers petites fournitures, etc. car le lendemain tout était disparu. Je reparlerais de cette période par la suite.
Après la guerre, les classes de fin d’études pour le fameux Certificat, étaient très dures car nous avions été perturbés dans nos scolarités à la suite des événements que l’on connaît.
Les programmes étaient très chargés et il fallait mettre les bouchées doubles.
Après les cérémonies, telles que les cérémonies du 11 novembre, foires-expositions, cirque ou cinéma pour les fêtes de fin d’année, dans les 2 ou 3 années avant le certificat d’études, nous avions le lendemain ou dans les jours suivants, une rédaction à rédiger sur le sujet.
Indépendamment du texte qu’il fallait imaginer, il ne fallait pas ou peu de fautes de Français ou d’accents dans la rédaction.
Un élève de ma scolarité de 1948/1949 Roger Marguillier, rédigeait des rédactions du tonnerre, de petits chefs d’œuvre. A chaque fois, l’instituteur lui demandait de nous lire à haute voix sa rédaction. J’avais une certaine admiration pour les textes de ce copain, car il avait un don de narration et d’écriture extraordinaires.
vendredi 24 avril 2009
Scolarité 1943-1944
Pendant ma scolarité 1943-1944, ma mère devint très malade, tout d’abord un zona puis une tuberculose pulmonaire et je fus obligé de partir dans un préventorium dans les Yvelines pour ne pas être en contact avec cette grave maladie très contagieuse.
J’arrêtais l’école en mars 1944, étant en classe avec Monsieur Lecointe, le fils d’un ancien Maire d’Amiens. J’ai donc fini le reste de cette scolarité en préventorium, dans une classe unique mais, avec plusieurs sections. Je ne perdis pas grand chose, je n’avais que 9 ans.
Il y eut un vague échange de courriers entre mes parents et le préventorium, parce que je n’étais pas baptisé et les Allemands recherchaient les enfants non baptisés. Mes parents finirent par accepter pour ce baptême, mais le courrier postal était très perturbé par la guerre
Le service postal, les chemins de fer étaient partiellement paralysés, désorganisés et l’acceptation n’est jamais arrivée. Heureusement, la Libération de la France arriva, coupant court à cette cérémonie.
Le préventorium « Plein Soleil » était à La Queue Les Yvelines, prés de Monfort L’Amaury, dans les Yvelines.
Nous fumes ballottés entre le préventorium dans le haut du pays et l’annexe en bas dans le village. A la Libération, nous sommes restés 3 jours et 3 nuits dans des abris, creusés dans la glaise et recouverts de rondins de bois. C’étaient des « abris » très symboliques, si une bombe était tombée dessus, il ne serait pas resté grand chose de nous.
Pour la Libération, nous portions tous au cou, une médaille de la Croix Rouge avec notre nom, prénom, adresse personnelle, en cas de dispersion.
Nous sommes restés dans cet abri, au moment de la libération du bourg, pendant trois jours, tout habillés, plus une pèlerine ample et un béret et je suis tombé malade.
J’y ai contracté une pleurite, (pleurésie sans épanchement, non purulente) et je fis une primo-infection à la tuberculose. Cette maladie m’a handicapé profondément, toute ma jeunesse, et toute ma vie.
Nous n’avions pas ou très peu de courrier, de nouvelles de nos familles.
Enfin, un jour mon père vint me voir, à vélo, d’Amiens, 175 kilomètres, en deux jours, peu après le Débarquement en Normandie. Il dormit à la belle étoile, dans une meule de paille. Il resta deux jours avec moi avant de reprendre le chemin du retour.
Quelle joie d’avoir des nouvelles de ma mère qui se rétablissait doucement. Il n’y avait pas les médicaments actuels et il y avait un rationnement pour le pain, le lait et la viande, surtout. Pour se nourrir, heureusement, mes parents avaient un grand jardin avec ses légumes frais, cela compensa le manque d’autres choses. Mais la peur des bombardements, de la soldatesque Allemande et les privations alimentaires ont engendré beaucoup de maladies.
Mon père m’avait apporté un peu de gâteries, gâteaux faits maison, bonbons, pains d’épices collectés auprès de tous. Certaines choses étant périssables, je les ai partagé avec des copains originaires d’Amiens et des alentours, Dupontreué de Bertangles, Rivet de Saleux. Un troisième copain d’Amiens, Michel Piccoli était reparti quelques semaines auparavant, Ses parents étaient venus le reprendre peu après le Débarquement, en prévision des événements qui allaient suivre. Mes parents ont bien regretté, par la suite, de ne pas avoir fait pareil pour moi, je n’aurais pas contracté cette pleurésie dans les abris, là bas.
Et mon père reprit la route toujours sur son vélo. Déchirements et pleurs pour tous deux, de ne pas savoir quand nous nous reverrions. et que je retrouverais enfin, ma mère.
J’arrêtais l’école en mars 1944, étant en classe avec Monsieur Lecointe, le fils d’un ancien Maire d’Amiens. J’ai donc fini le reste de cette scolarité en préventorium, dans une classe unique mais, avec plusieurs sections. Je ne perdis pas grand chose, je n’avais que 9 ans.
Il y eut un vague échange de courriers entre mes parents et le préventorium, parce que je n’étais pas baptisé et les Allemands recherchaient les enfants non baptisés. Mes parents finirent par accepter pour ce baptême, mais le courrier postal était très perturbé par la guerre
Le service postal, les chemins de fer étaient partiellement paralysés, désorganisés et l’acceptation n’est jamais arrivée. Heureusement, la Libération de la France arriva, coupant court à cette cérémonie.
Le préventorium « Plein Soleil » était à La Queue Les Yvelines, prés de Monfort L’Amaury, dans les Yvelines.
Nous fumes ballottés entre le préventorium dans le haut du pays et l’annexe en bas dans le village. A la Libération, nous sommes restés 3 jours et 3 nuits dans des abris, creusés dans la glaise et recouverts de rondins de bois. C’étaient des « abris » très symboliques, si une bombe était tombée dessus, il ne serait pas resté grand chose de nous.
Pour la Libération, nous portions tous au cou, une médaille de la Croix Rouge avec notre nom, prénom, adresse personnelle, en cas de dispersion.
Nous sommes restés dans cet abri, au moment de la libération du bourg, pendant trois jours, tout habillés, plus une pèlerine ample et un béret et je suis tombé malade.
J’y ai contracté une pleurite, (pleurésie sans épanchement, non purulente) et je fis une primo-infection à la tuberculose. Cette maladie m’a handicapé profondément, toute ma jeunesse, et toute ma vie.
Nous n’avions pas ou très peu de courrier, de nouvelles de nos familles.
Enfin, un jour mon père vint me voir, à vélo, d’Amiens, 175 kilomètres, en deux jours, peu après le Débarquement en Normandie. Il dormit à la belle étoile, dans une meule de paille. Il resta deux jours avec moi avant de reprendre le chemin du retour.
Quelle joie d’avoir des nouvelles de ma mère qui se rétablissait doucement. Il n’y avait pas les médicaments actuels et il y avait un rationnement pour le pain, le lait et la viande, surtout. Pour se nourrir, heureusement, mes parents avaient un grand jardin avec ses légumes frais, cela compensa le manque d’autres choses. Mais la peur des bombardements, de la soldatesque Allemande et les privations alimentaires ont engendré beaucoup de maladies.
Mon père m’avait apporté un peu de gâteries, gâteaux faits maison, bonbons, pains d’épices collectés auprès de tous. Certaines choses étant périssables, je les ai partagé avec des copains originaires d’Amiens et des alentours, Dupontreué de Bertangles, Rivet de Saleux. Un troisième copain d’Amiens, Michel Piccoli était reparti quelques semaines auparavant, Ses parents étaient venus le reprendre peu après le Débarquement, en prévision des événements qui allaient suivre. Mes parents ont bien regretté, par la suite, de ne pas avoir fait pareil pour moi, je n’aurais pas contracté cette pleurésie dans les abris, là bas.
Et mon père reprit la route toujours sur son vélo. Déchirements et pleurs pour tous deux, de ne pas savoir quand nous nous reverrions. et que je retrouverais enfin, ma mère.
jeudi 23 avril 2009
Pour la route
Pour la route, mon père avait, à son dos, prêtés par des voisins (toujours la pénurie) deux pneus et deux chambres à air, en prévision de crevaisons ou d’éclatements de ces derniers. Ce n’était pas la qualité du matériel que l’on connaît actuellement et les routes étaient bouleversées par les tanks et la guerre.
Il m’a fallut attendre plusieurs mois avant de revoir ma famille. Il faut s’imaginer être seul si loin de mes parents, de tous, recevant très peu de lettres, de nouvelles sur la santé de ma mère qui se rétablissait doucement de cette terrible maladie, avec beaucoup de repos, de médicaments et de piqûres. C’est dingue, c’est fou, cette situation à 9 ans.
Un jour, on me fit appeler dans un bureau du préventorium et ma mère était, enfin, là.
Presque guérie, elle est venue me voir le 8 novembre 1944. Accompagnée d’une cousine Giséle Pecquery. Ma mère était furieuse que je sois malade et a exigé de me reprendre sur l’heure, inflexible, argumentant que j’étais arrivé en bonne santé et là, 8 mois plus tard, j’étais très malade et qu’après tout, un préventorium n’était pas une prison et que l’on pouvait en sortir quand on le voulait.
Nous avons quitté le préventorium, le 8 novembre et prit le train à la gare de La Queue Les Yvelines, juste derrière l’annexe, en bas du pays. Le train nous emmena à Versailles où nous avons dormi dans une famille qui nous avait été recommandée. Par qui ?
J’étais sur un petit nuage, j’avais retrouvé ma mère, c’était l’essentiel et j’allais rentrer à la maison après 8 mois de déchirements, d’angoisses et de maladies, loin des miens.
Le lendemain, nous avons repris le train jusqu’à Paris. Et là, pas de train vers Amiens
La Libération n’avait eu lieu que 3 ou 4 mois auparavant, selon les régions et le réseau ferro-viaire n’était qu’en partie rétabli, surtout au Nord de la Loire où les voies ferrées avaient le plus souffert par les bombardements des Alliés.
Obligés de faire du « stop » ou de se débrouiller pour revenir vers Amiens. De bouche à oreille, ma mère a découvert un camion qui se dirigeait vers notre région et qui voulut bien nous prendre. Au milieu de ballots, nous sommes revenus, sur ce camion débâché, ouvert à tout vent, et il pleuvait sans cesse, jusqu’à Poix de Picardie à 27 kilomètres de chez nous. Et de ce bourg vers Amiens en jeep. Mais il faut le dire, c’était toujours en payant, bien sûr.
Quelle joie de se retrouver avec ses parents, après une si longue absence et tous les événements qui se sont déroulés depuis mon départ.
Deux jours après mon retour, le 11 novembre 1944 avec ma mère, nous sommes allés aux cérémonies au Monument aux Morts, place du Général Foch.
Je me souviens, encore, que cela sentait bon le tabac Anglais et de tous ces uniformes différents, ceux-ci nous changeaient de ceux que l’on voyait depuis quatre ans.
Il faisait très froid, il y avait du vent, de la pluie et j’avais un béret sur la tête. J’écoutais les hymnes nationaux. Mon béret s’envola d’une pichenette provoquée par un « ancien » qui était debout derrière moi et qui m’a dit brutalement :
- Alors, tu ne peux pas te découvrir comme tout le monde ?
Rien à redire. Ma mère s’excusa, en disant à cet homme que je venais d’être très malade.
Et pourtant, quand on voit, maintenant, les jeunes, la casquette de « rappeur » vissée sur la tête et que l’on siffle notre Marseillaise, là, c’est écoeurant !
Il m’a fallut attendre plusieurs mois avant de revoir ma famille. Il faut s’imaginer être seul si loin de mes parents, de tous, recevant très peu de lettres, de nouvelles sur la santé de ma mère qui se rétablissait doucement de cette terrible maladie, avec beaucoup de repos, de médicaments et de piqûres. C’est dingue, c’est fou, cette situation à 9 ans.
Un jour, on me fit appeler dans un bureau du préventorium et ma mère était, enfin, là.
Presque guérie, elle est venue me voir le 8 novembre 1944. Accompagnée d’une cousine Giséle Pecquery. Ma mère était furieuse que je sois malade et a exigé de me reprendre sur l’heure, inflexible, argumentant que j’étais arrivé en bonne santé et là, 8 mois plus tard, j’étais très malade et qu’après tout, un préventorium n’était pas une prison et que l’on pouvait en sortir quand on le voulait.
Nous avons quitté le préventorium, le 8 novembre et prit le train à la gare de La Queue Les Yvelines, juste derrière l’annexe, en bas du pays. Le train nous emmena à Versailles où nous avons dormi dans une famille qui nous avait été recommandée. Par qui ?
J’étais sur un petit nuage, j’avais retrouvé ma mère, c’était l’essentiel et j’allais rentrer à la maison après 8 mois de déchirements, d’angoisses et de maladies, loin des miens.
Le lendemain, nous avons repris le train jusqu’à Paris. Et là, pas de train vers Amiens
La Libération n’avait eu lieu que 3 ou 4 mois auparavant, selon les régions et le réseau ferro-viaire n’était qu’en partie rétabli, surtout au Nord de la Loire où les voies ferrées avaient le plus souffert par les bombardements des Alliés.
Obligés de faire du « stop » ou de se débrouiller pour revenir vers Amiens. De bouche à oreille, ma mère a découvert un camion qui se dirigeait vers notre région et qui voulut bien nous prendre. Au milieu de ballots, nous sommes revenus, sur ce camion débâché, ouvert à tout vent, et il pleuvait sans cesse, jusqu’à Poix de Picardie à 27 kilomètres de chez nous. Et de ce bourg vers Amiens en jeep. Mais il faut le dire, c’était toujours en payant, bien sûr.
Quelle joie de se retrouver avec ses parents, après une si longue absence et tous les événements qui se sont déroulés depuis mon départ.
Deux jours après mon retour, le 11 novembre 1944 avec ma mère, nous sommes allés aux cérémonies au Monument aux Morts, place du Général Foch.
Je me souviens, encore, que cela sentait bon le tabac Anglais et de tous ces uniformes différents, ceux-ci nous changeaient de ceux que l’on voyait depuis quatre ans.
Il faisait très froid, il y avait du vent, de la pluie et j’avais un béret sur la tête. J’écoutais les hymnes nationaux. Mon béret s’envola d’une pichenette provoquée par un « ancien » qui était debout derrière moi et qui m’a dit brutalement :
- Alors, tu ne peux pas te découvrir comme tout le monde ?
Rien à redire. Ma mère s’excusa, en disant à cet homme que je venais d’être très malade.
Et pourtant, quand on voit, maintenant, les jeunes, la casquette de « rappeur » vissée sur la tête et que l’on siffle notre Marseillaise, là, c’est écoeurant !
mercredi 22 avril 2009
Ecole : janvier 1945
Je repris l’école en janvier 1945, mais comme je l’ai, déjà, signalé, nous allions en classe avec des horaires alternés, contraignants, soit le matin soit l’après-midi. Il ne faisait pas très chaud dans les classes, l’ambiance était déplorable et les conditions d’études difficiles.
Cela a duré plusieurs semaines ainsi, et comme j’avais été bien malade auparavant, et de santé toujours fragile, mes parents décidèrent que je devais quitter l’école pour l’instant afin de mieux me requinquer.
Par l’intermédiaire de la Croix Rouge, je devais partir (une nouvelle fois) en Suisse, en convalescence dans un autre préventorium au printemps 1945.
Mais il fallait que je sois baptisé. Je le fus, donc, en mars 1945. Mais je ne suivais pas de cours de catéchisme, alors je ne suis pas parti, car il m’aurait fallu un minimum de connaissances de la religion.
Ma marraine était une voisine, infirmière à l’hôpital, vivant avec sa mère à quelques maisons de chez nous. Mon parrain était un militaire réserviste, ancien marbrier du quartier pour lequel mon père avait travaillé avant la guerre, en lui construisant des caveaux funéraires au cimetière de la Madeleine à Amiens.
N’allant plus à l’école, pour l’instant, je devais suivre des cours de Français, de calcul, etc. Ces cours m’étaient donnés par la mère de ma marraine, qui avait été longtemps institutrice. Cette dernière ne me faisait pas de cadeaux, dictées, problèmes de calcul, lectures de petits textes, conjugaisons que sais-je encore ? Bref, un peu ce que j’aurais fait à l’école, sauf que là je n’avais pas de cours de sciences, d’histoire ou de géographie. J’allais chez elles deux ou trois fois par semaine mais j’avais des devoirs à faire et des leçons à apprendre, à la maison et ma mère veillait à ce que j’étudie comme si j’allais à l’école. Si bien, que je n’ai pas perdu grand chose, sauf dans certaines matières que je viens de citer plus haut.
Je repris l’école primaire en janvier 1946, en troisième (de l’époque) avec comme instituteur Monsieur Joly Ernest. Il était le frère de la cultivatrice qui nous avait accueilli à Talmas, à 15 kilomètres d’Amiens, au cours de l’exode de 1940.
Cela faisait, prés de 2 ans que je n’étais pas allé, vraiment, à l’école de Saint Maurice.
J’ai fini cette scolarité 1945/1946 sans problème et je passais en « seconde » en octobre 1946 dans la classe de Monsieur Hénaut, pour un mois seulement. Ce dernier était petit, environ 1m55, passionné de football et de pêche à la ligne.
Une nouvelle fois, je tombais gravement malade. Encéphalite. Je tombais dans le coma, pendant une quinzaine de jours puis cela s’arrangea grâce à des injections de la toute nouvelle pénicilline.
Au début de ma convalescence, j’avais un très sévère strabisme et je me tenais de travers, la bouche était déformée, mais au fur et à mesure tout se débloqua et redevint normal.
Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des souvenirs de mon école primaire, mais la guerre, et les maladies ont influencé toute ma scolarité.
Je n’avais pas le droit de faire de sport et je n’ai jamais passé le « Brevet Sportif »
Heureusement, je nageais très bien. Je n’ai jamais appris. Vers 3 ou 4 ans, mon père m’avait mis à l’eau dans le canal et j’ai barboté, de suite, seul. Mais, mes parents n’aimaient pas beaucoup que je n’aille nager de peur que j’eus froid et que je tombe de nouveau malade.
Mais pour moi, c’était un dérivatif, alors quand, j’arrivais à me sauver, j’allais me baigner seul, dans le canal, à proximité. Ma mère ne devait pas être dupe de mes petites escapades.
L’eau de la rivière et du canal, en ces moments là, était très propre, pas comme actuellement.
Cela a duré plusieurs semaines ainsi, et comme j’avais été bien malade auparavant, et de santé toujours fragile, mes parents décidèrent que je devais quitter l’école pour l’instant afin de mieux me requinquer.
Par l’intermédiaire de la Croix Rouge, je devais partir (une nouvelle fois) en Suisse, en convalescence dans un autre préventorium au printemps 1945.
Mais il fallait que je sois baptisé. Je le fus, donc, en mars 1945. Mais je ne suivais pas de cours de catéchisme, alors je ne suis pas parti, car il m’aurait fallu un minimum de connaissances de la religion.
Ma marraine était une voisine, infirmière à l’hôpital, vivant avec sa mère à quelques maisons de chez nous. Mon parrain était un militaire réserviste, ancien marbrier du quartier pour lequel mon père avait travaillé avant la guerre, en lui construisant des caveaux funéraires au cimetière de la Madeleine à Amiens.
N’allant plus à l’école, pour l’instant, je devais suivre des cours de Français, de calcul, etc. Ces cours m’étaient donnés par la mère de ma marraine, qui avait été longtemps institutrice. Cette dernière ne me faisait pas de cadeaux, dictées, problèmes de calcul, lectures de petits textes, conjugaisons que sais-je encore ? Bref, un peu ce que j’aurais fait à l’école, sauf que là je n’avais pas de cours de sciences, d’histoire ou de géographie. J’allais chez elles deux ou trois fois par semaine mais j’avais des devoirs à faire et des leçons à apprendre, à la maison et ma mère veillait à ce que j’étudie comme si j’allais à l’école. Si bien, que je n’ai pas perdu grand chose, sauf dans certaines matières que je viens de citer plus haut.
Je repris l’école primaire en janvier 1946, en troisième (de l’époque) avec comme instituteur Monsieur Joly Ernest. Il était le frère de la cultivatrice qui nous avait accueilli à Talmas, à 15 kilomètres d’Amiens, au cours de l’exode de 1940.
Cela faisait, prés de 2 ans que je n’étais pas allé, vraiment, à l’école de Saint Maurice.
J’ai fini cette scolarité 1945/1946 sans problème et je passais en « seconde » en octobre 1946 dans la classe de Monsieur Hénaut, pour un mois seulement. Ce dernier était petit, environ 1m55, passionné de football et de pêche à la ligne.
Une nouvelle fois, je tombais gravement malade. Encéphalite. Je tombais dans le coma, pendant une quinzaine de jours puis cela s’arrangea grâce à des injections de la toute nouvelle pénicilline.
Au début de ma convalescence, j’avais un très sévère strabisme et je me tenais de travers, la bouche était déformée, mais au fur et à mesure tout se débloqua et redevint normal.
Bien sûr, ce ne sont pas vraiment des souvenirs de mon école primaire, mais la guerre, et les maladies ont influencé toute ma scolarité.
Je n’avais pas le droit de faire de sport et je n’ai jamais passé le « Brevet Sportif »
Heureusement, je nageais très bien. Je n’ai jamais appris. Vers 3 ou 4 ans, mon père m’avait mis à l’eau dans le canal et j’ai barboté, de suite, seul. Mais, mes parents n’aimaient pas beaucoup que je n’aille nager de peur que j’eus froid et que je tombe de nouveau malade.
Mais pour moi, c’était un dérivatif, alors quand, j’arrivais à me sauver, j’allais me baigner seul, dans le canal, à proximité. Ma mère ne devait pas être dupe de mes petites escapades.
L’eau de la rivière et du canal, en ces moments là, était très propre, pas comme actuellement.
mardi 21 avril 2009
Scolarité 1946-1947
Le reste de ma scolarité 1946/1947 se passa normalement avec cet instituteur Monsieur Hénaut. Il avait réussi à percer un trou de 2 cms de diamètre dans le mur ( de 40 cms d’épaisseur ) et regardait dans la classe voisine, l’institutrice, Mademoiselle Devillers qui enseignait le cours préparatoire. Ils se glissaient des mots doux par ce trou. Lui même, étant divorcé, ils se marièrent peu de temps après. Monsieur Hénaut nous disait souvent :
-Vous verrez, l’année prochaine, chez le « patron », vous allez vous faire dresser !
Le « patron » était le directeur Monsieur Homet, qui enseignait dans la classe de fin d’études pour le Certificat d’Etudes, dite la Première. Ceux, devant « monter » avec ce dernier, n’étaient pas très fiers, très sûrs d’eux.
Chance ou malchance, je montais dans cette classe de fin d’études, en octobre 1947 et j’y retrouvais Monsieur Joly Ernest qui passait de la troisième à la première classe et j’ai fini mes deux dernières années avec celui-ci, jusqu’à mon Certificat d’Etudes. Le directeur Monsieur Homet n’assurant plus que les fonctions directoriales et ne donnait plus de cours.
Nous ne passions le Certificat d’Etudes que dans l’année de nos quatorze ans, ce qui était une erreur, surtout pour ceux ( ou celles ) natifs du début de l’année, comme moi.
Mes parents me jugeant un peu faible, un peu en retard dans le programme, ( et peut être pour m’occuper un peu ) me firent donner des cours pendant les vacances d’été de 1948, par Joly Ernest, à son domicile, Passage Strock. Je n’étais pas seul.
Nous étions trois, Jacques Niopel, Serge Toso et moi même. En plus des cours, nous avions des exercices à faire à la maison et pour moi, des leçons à apprendre d’histoire, de géographie, de sciences, pour me remettre au niveau des classes de fin d’études.
Je connaissais, déjà, Serge Toso de l’école Saint Maurice, mais Jacques Niopel, arrivé depuis peu avec nous, « monta » en classe de fin d’études avec moi, et nous avons fini notre dernière année de primaire et passer notre fameux Certificat d’Etudes, ensemble.
Nous avons, naturellement, fait notre voyage de fin d’études à Paris avec le groupe. En cours, Jacques Niopel partait, très souvent vers 17 heures pour suivre des cours de musique au conservatoire dont il devint, par la suite, l’un des professeurs. Je crois me souvenir que sa marraine vendait des pianos dans le centre de la ville.
Je me souviens qu’en cours, Jacques mettait des manchettes de tissu noir sur ses avant-bras pour se protéger.
Ah ! Cette fameuse encre violette, dans son encrier en porcelaine, dans lequel nous faisions tremper des hannetons vivants. Posés sur une feuille de papier, ils faisaient de curieuses arabesques. Même chose pour les civelles, attrapées dans la rivière prés de l’école.
Il ne fallait pas se faire pincer par le magister. C’était la punition assurée.
Au milieu de la semaine, nous avions la journée complète du jeudi, en repos, alors que c’est le mercredi actuellement, mais nous allions en classe tous les samedis, toute la journée et cela jusqu’à 17 heures.
-Vous verrez, l’année prochaine, chez le « patron », vous allez vous faire dresser !
Le « patron » était le directeur Monsieur Homet, qui enseignait dans la classe de fin d’études pour le Certificat d’Etudes, dite la Première. Ceux, devant « monter » avec ce dernier, n’étaient pas très fiers, très sûrs d’eux.
Chance ou malchance, je montais dans cette classe de fin d’études, en octobre 1947 et j’y retrouvais Monsieur Joly Ernest qui passait de la troisième à la première classe et j’ai fini mes deux dernières années avec celui-ci, jusqu’à mon Certificat d’Etudes. Le directeur Monsieur Homet n’assurant plus que les fonctions directoriales et ne donnait plus de cours.
Nous ne passions le Certificat d’Etudes que dans l’année de nos quatorze ans, ce qui était une erreur, surtout pour ceux ( ou celles ) natifs du début de l’année, comme moi.
Mes parents me jugeant un peu faible, un peu en retard dans le programme, ( et peut être pour m’occuper un peu ) me firent donner des cours pendant les vacances d’été de 1948, par Joly Ernest, à son domicile, Passage Strock. Je n’étais pas seul.
Nous étions trois, Jacques Niopel, Serge Toso et moi même. En plus des cours, nous avions des exercices à faire à la maison et pour moi, des leçons à apprendre d’histoire, de géographie, de sciences, pour me remettre au niveau des classes de fin d’études.
Je connaissais, déjà, Serge Toso de l’école Saint Maurice, mais Jacques Niopel, arrivé depuis peu avec nous, « monta » en classe de fin d’études avec moi, et nous avons fini notre dernière année de primaire et passer notre fameux Certificat d’Etudes, ensemble.
Nous avons, naturellement, fait notre voyage de fin d’études à Paris avec le groupe. En cours, Jacques Niopel partait, très souvent vers 17 heures pour suivre des cours de musique au conservatoire dont il devint, par la suite, l’un des professeurs. Je crois me souvenir que sa marraine vendait des pianos dans le centre de la ville.
Je me souviens qu’en cours, Jacques mettait des manchettes de tissu noir sur ses avant-bras pour se protéger.
Ah ! Cette fameuse encre violette, dans son encrier en porcelaine, dans lequel nous faisions tremper des hannetons vivants. Posés sur une feuille de papier, ils faisaient de curieuses arabesques. Même chose pour les civelles, attrapées dans la rivière prés de l’école.
Il ne fallait pas se faire pincer par le magister. C’était la punition assurée.
Au milieu de la semaine, nous avions la journée complète du jeudi, en repos, alors que c’est le mercredi actuellement, mais nous allions en classe tous les samedis, toute la journée et cela jusqu’à 17 heures.
lundi 20 avril 2009
Vacances d’été
Nous étions en vacances d’été aux alentours du 14 juillet pour reprendre les cours vers le premier octobre. Nous avions une dizaine de jours aux alentours de Noël et du Nouvel An, 15 jours à Pâques, et 8 jours à la Pentecôte.
Mais pas une seule journée à Mardi Gras. Les lobbies du tourisme et les stations de sports d’hiver n’influençaient pas, encore, les gouvernements successifs.
Pourquoi les vacances au 14 Juillet ? Pour que les jeunes des campagnes puissent participer, avantageusement, aux moissons et aux vendanges. Pareillement pour le ramassage des pommes de terre pour les producteurs de celles-ci ou la mise en tas ou le chargement des bottes de paille sur les remorques, pendant les vacances d’été. Il y avait, aussi le glanage de blé ou de pommes de terre pour les parents. Toujours la pénurie et la pauvreté et les cultivateurs n’étaient pas, encore, modernisés comme maintenant.
Les jeunes des campagnes, en guise de classes vertes, allaient dans les champs de pommes de terre pour y ramasser les doryphores, pendant les heures d’école. Surtout dans le Santerre. Région productrice de pommes de terre.
Quant aux horaires normaux, après la réhabilitation de l’école des filles, rue Cagnard, étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures mais bien souvent, selon les classes, il y avait une heure d’étude en plus, le soir, pour le samedi nous gardions cet horaire mais nous quittions tous l’école à 17 heures.
Dans la classe de fin d’études, on restait, bien souvent, jusqu’à 18 heures 45, peu ou pas de récréations, on allait aux toilettes, on mangeait un casse-croûte sur le pouce et c’était reparti jusqu’en début de soirée. Le soir, nous avions, encore, des leçons à apprendre pour le lendemain ou le surlendemain.
Au moins la moitié du jeudi était nécessaire pour faire des exercices et apprendre des leçons très diverses. Malheur à celui qui se laissait déborder. Heureusement ces leçons étaient pour des interrogations écrites, c’était plus facile que de réciter des textes. Sauf pour les récitations qui devaient être connues, retenues par cœur.
Mais pas une seule journée à Mardi Gras. Les lobbies du tourisme et les stations de sports d’hiver n’influençaient pas, encore, les gouvernements successifs.
Pourquoi les vacances au 14 Juillet ? Pour que les jeunes des campagnes puissent participer, avantageusement, aux moissons et aux vendanges. Pareillement pour le ramassage des pommes de terre pour les producteurs de celles-ci ou la mise en tas ou le chargement des bottes de paille sur les remorques, pendant les vacances d’été. Il y avait, aussi le glanage de blé ou de pommes de terre pour les parents. Toujours la pénurie et la pauvreté et les cultivateurs n’étaient pas, encore, modernisés comme maintenant.
Les jeunes des campagnes, en guise de classes vertes, allaient dans les champs de pommes de terre pour y ramasser les doryphores, pendant les heures d’école. Surtout dans le Santerre. Région productrice de pommes de terre.
Quant aux horaires normaux, après la réhabilitation de l’école des filles, rue Cagnard, étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures mais bien souvent, selon les classes, il y avait une heure d’étude en plus, le soir, pour le samedi nous gardions cet horaire mais nous quittions tous l’école à 17 heures.
Dans la classe de fin d’études, on restait, bien souvent, jusqu’à 18 heures 45, peu ou pas de récréations, on allait aux toilettes, on mangeait un casse-croûte sur le pouce et c’était reparti jusqu’en début de soirée. Le soir, nous avions, encore, des leçons à apprendre pour le lendemain ou le surlendemain.
Au moins la moitié du jeudi était nécessaire pour faire des exercices et apprendre des leçons très diverses. Malheur à celui qui se laissait déborder. Heureusement ces leçons étaient pour des interrogations écrites, c’était plus facile que de réciter des textes. Sauf pour les récitations qui devaient être connues, retenues par cœur.
dimanche 19 avril 2009
Qui se souvient
Qui se souvient, encore, de ces moments redoutés de calcul mental ou des tables de multiplication de 12, 13, 14, en interrogations écrites ?
Souvenez-vous, encore, des dictées des mots difficiles.
Thym, tain, teint (du verbe tenir) tint (du verbe teindre), laurier-tin.
Seau, sot, saut, sceau, et les villes, Saulx, Sault.
Sain, sein, seing, Saint, ceint (du verbe ceindre).
Et les terminaisons, telles que, fourmi, souris, scie, roussi, mie (de pain), sourit ou souris (du verbe sourire) habit, fournil, semis, outil, sympathie, ortie, etc.
Rappelez vous, aussi, plus difficile, la dictée de mots où il fallait deviner le genre,
Masculin ou féminin, ou les deux genres pour un même mot.
Masculin, hémisphère, catafalque, obélisque, tubercule, après-midi, chrysanthème alvéole, etc
Féminin, alvéole, échauffourée, écritoire, espèce, volute, orbite, épithète, azalée, omoplate etc
avec les accents adéquats, aigus, graves, ou circonflexes, ¼ de faute par accent mal disposé.
Et ces cinq mots (que je me souvienne seulement) qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel, Cartouche, Délice, amour, hymne et orgue. Il y en a certainement d’autres !
Les instituteurs nous donnaient aussi des « tuyaux » pour mémoriser des mots tels que
Alléger avec deux L, « ailes » ( pour être plus léger )
Alourdir avec un L ( pour rester sur terre )
Marche à pieds ( bien que la marche se pratique toujours à pieds ) il fallait un S à pieds, car on marche avec les deux pieds. On doit dire, je vais me laver LES mains, car on sait très, bien que l’on ne va pas laver les mains du copain et je ne rappelle plus tous ces « tuyaux »
Vous rappelez-vous des conjonctions de coordination… Mais, où, et, donc, or, ni, car.
Et les comptoirs Français des Indes, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Pondichéry et Mahé.
En arithmétique, on se rappelle , des multiplications avec le multiplicande et le multi- plicateur à 5 ou 6 chiffres chacun et les divisions avec un dividende à 6 ou 7 chiffres et le diviseur à 3 ou 4 chiffres et pour corser un peu la chose, avec des 0 ou des virgules, bref, tout pour nous empoisonner la vie. Et les calculettes n’existaient pas en ce temps là. Au fait, vous rappelez, vous cette fameuse règle de trois, que l’on était tenu à ânonner très souvent ? Ainsi que ces fameux robinets qui fuyaient ou de trains qui se croisaient ?
La fille de notre instituteur, Josette Joly, à 10 ou 11 ans faisait les mêmes opérations que nous qui avions, aux environs de 14 ans. Son père était sévère, comme avec nous, d’ailleurs.
C’était un ancien militaire, qui avait passé toute la guerre de 1939/1945, en Afrique du Nord. Il connaissait cette grande région, par cœur, et il avait rapporté de là bas de magnifiques souvenirs, Couffins, coussins, tapis, vues, tableaux, poufs, etc. Notre instituteur était passionné par les trois nations Tunisie, Algérie, Maroc qui sont maintenant indépendantes.
Souvenez-vous, encore, des dictées des mots difficiles.
Thym, tain, teint (du verbe tenir) tint (du verbe teindre), laurier-tin.
Seau, sot, saut, sceau, et les villes, Saulx, Sault.
Sain, sein, seing, Saint, ceint (du verbe ceindre).
Et les terminaisons, telles que, fourmi, souris, scie, roussi, mie (de pain), sourit ou souris (du verbe sourire) habit, fournil, semis, outil, sympathie, ortie, etc.
Rappelez vous, aussi, plus difficile, la dictée de mots où il fallait deviner le genre,
Masculin ou féminin, ou les deux genres pour un même mot.
Masculin, hémisphère, catafalque, obélisque, tubercule, après-midi, chrysanthème alvéole, etc
Féminin, alvéole, échauffourée, écritoire, espèce, volute, orbite, épithète, azalée, omoplate etc
avec les accents adéquats, aigus, graves, ou circonflexes, ¼ de faute par accent mal disposé.
Et ces cinq mots (que je me souvienne seulement) qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel, Cartouche, Délice, amour, hymne et orgue. Il y en a certainement d’autres !
Les instituteurs nous donnaient aussi des « tuyaux » pour mémoriser des mots tels que
Alléger avec deux L, « ailes » ( pour être plus léger )
Alourdir avec un L ( pour rester sur terre )
Marche à pieds ( bien que la marche se pratique toujours à pieds ) il fallait un S à pieds, car on marche avec les deux pieds. On doit dire, je vais me laver LES mains, car on sait très, bien que l’on ne va pas laver les mains du copain et je ne rappelle plus tous ces « tuyaux »
Vous rappelez-vous des conjonctions de coordination… Mais, où, et, donc, or, ni, car.
Et les comptoirs Français des Indes, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Pondichéry et Mahé.
En arithmétique, on se rappelle , des multiplications avec le multiplicande et le multi- plicateur à 5 ou 6 chiffres chacun et les divisions avec un dividende à 6 ou 7 chiffres et le diviseur à 3 ou 4 chiffres et pour corser un peu la chose, avec des 0 ou des virgules, bref, tout pour nous empoisonner la vie. Et les calculettes n’existaient pas en ce temps là. Au fait, vous rappelez, vous cette fameuse règle de trois, que l’on était tenu à ânonner très souvent ? Ainsi que ces fameux robinets qui fuyaient ou de trains qui se croisaient ?
La fille de notre instituteur, Josette Joly, à 10 ou 11 ans faisait les mêmes opérations que nous qui avions, aux environs de 14 ans. Son père était sévère, comme avec nous, d’ailleurs.
C’était un ancien militaire, qui avait passé toute la guerre de 1939/1945, en Afrique du Nord. Il connaissait cette grande région, par cœur, et il avait rapporté de là bas de magnifiques souvenirs, Couffins, coussins, tapis, vues, tableaux, poufs, etc. Notre instituteur était passionné par les trois nations Tunisie, Algérie, Maroc qui sont maintenant indépendantes.
samedi 18 avril 2009
Dictées, interro...
Pour la plupart des différentes dictées ou des interrogations écrites, nous passions notre cahier au copain derrière nous, le dernier de la rangée portait son cahier au premier et nous corrigions les éventuelles fautes d’orthographe, de dates d’histoire ou de calcul mental.
Nous corrigions le devoir ou l’exercice du copain qui était devant nous, en écoutant un élève qui annonçait les bonnes réponses ou épelait les dictées.
Après la comptabilisation des fautes, punition, de 30 à 50 fois à copier, le soir après 18 heures. Inutile de dire que je suis resté, bien souvent en classe, jusqu’à près de 19 heures.
Même système de corrections et de punitions pour les questions de géographie et de dates d’histoire.
L’instituteur corrigeait peu de devoirs, mais les contrôlait seulement, sauf, évidemment les rédactions, les dessins ou les fameuses pages d’écriture avec les pleins et les déliés. Très peu pour moi, ces trois rubriques !
Nous avions beaucoup plus d’heures de classe, que maintenant, ainsi que beaucoup de « devoirs ou d’exercices », à réaliser, ou de leçons à apprendre à la maison, surtout le jeudi, nous étions, certainement plus fatigués que les jeunes actuellement, mais nous n’en sommes pas morts pour autant.
Mais, à 14 ans, la très grande majorité des adolescents savait lire correctement, à haute voix, d’une manière audible, avait de bonnes bases, en Français et en calcul, ne faisait pas trop de fautes d’accord avec les verbes ainsi que dans l’écriture des mots compliqués de la Langue Française. Mais, hélas, beaucoup de jeunes étaient, pour différentes raisons, obligés de travailler vers 14 ans et ainsi oubliaient vite leur instruction de l’école primaire.
Aux abords des fêtes de noël ou des vacances d’été, les « grands » de la classe de fin d’études allaient dans les « petites » classes pour lire un conte ou un récit pour les tout petits.
Il fallait lire, distinctement, à haute voix, pour ces jeunes élèves, des textes, avec les liaisons, marquer un temps d’arrêt en fin de chapitre, avec les intonations nécessaires, ce n’était pas évident.
Ah ! Ces pages d’écriture , à la plume, car le premier stylo à bille, que j’ai vu, c’était en 1947 et appartenait à un bon copain, Gérard Caillouet. C’était très onéreux.
On se rappelle, sans nostalgie, sans aucun regret, ces pages d’écriture, en lettres majuscules, tout l’alphabet, à la plume, Sergent Major ou Baignol et Farjon, avec des traits pleins ou déliés, si possible bien réguliers, en tirant la langue, les doigts maculés d’encre.
Ecriture peu réussie, page déchirée et on devait recommencer, le soir même, le jeudi, ou le week-end, comme punition, à la maison.
Quant aux pupitres d’école, qu’il fallait gratter avec des morceaux de verre, puis cirer pour la scolarité suivante. Cela nous obligeait à faire attention, à ne rien renverser. Alors de là, à entailler ou graver dans les tables, il ne fallait, même pas, y songer.
On se souvient, avec le sourire, des crayons à encre, violette, dont il fallait mouiller la mine pour que l’encre marque sur le papier.
Si l’on avait pas de petite éponge à portée de mains, nous humidifions la mine avec la langue. Vous imaginez aisément la couleur de la langue après un usage assez intensif de ce crayon.
Nous corrigions le devoir ou l’exercice du copain qui était devant nous, en écoutant un élève qui annonçait les bonnes réponses ou épelait les dictées.
Après la comptabilisation des fautes, punition, de 30 à 50 fois à copier, le soir après 18 heures. Inutile de dire que je suis resté, bien souvent en classe, jusqu’à près de 19 heures.
Même système de corrections et de punitions pour les questions de géographie et de dates d’histoire.
L’instituteur corrigeait peu de devoirs, mais les contrôlait seulement, sauf, évidemment les rédactions, les dessins ou les fameuses pages d’écriture avec les pleins et les déliés. Très peu pour moi, ces trois rubriques !
Nous avions beaucoup plus d’heures de classe, que maintenant, ainsi que beaucoup de « devoirs ou d’exercices », à réaliser, ou de leçons à apprendre à la maison, surtout le jeudi, nous étions, certainement plus fatigués que les jeunes actuellement, mais nous n’en sommes pas morts pour autant.
Mais, à 14 ans, la très grande majorité des adolescents savait lire correctement, à haute voix, d’une manière audible, avait de bonnes bases, en Français et en calcul, ne faisait pas trop de fautes d’accord avec les verbes ainsi que dans l’écriture des mots compliqués de la Langue Française. Mais, hélas, beaucoup de jeunes étaient, pour différentes raisons, obligés de travailler vers 14 ans et ainsi oubliaient vite leur instruction de l’école primaire.
Aux abords des fêtes de noël ou des vacances d’été, les « grands » de la classe de fin d’études allaient dans les « petites » classes pour lire un conte ou un récit pour les tout petits.
Il fallait lire, distinctement, à haute voix, pour ces jeunes élèves, des textes, avec les liaisons, marquer un temps d’arrêt en fin de chapitre, avec les intonations nécessaires, ce n’était pas évident.
Ah ! Ces pages d’écriture , à la plume, car le premier stylo à bille, que j’ai vu, c’était en 1947 et appartenait à un bon copain, Gérard Caillouet. C’était très onéreux.
On se rappelle, sans nostalgie, sans aucun regret, ces pages d’écriture, en lettres majuscules, tout l’alphabet, à la plume, Sergent Major ou Baignol et Farjon, avec des traits pleins ou déliés, si possible bien réguliers, en tirant la langue, les doigts maculés d’encre.
Ecriture peu réussie, page déchirée et on devait recommencer, le soir même, le jeudi, ou le week-end, comme punition, à la maison.
Quant aux pupitres d’école, qu’il fallait gratter avec des morceaux de verre, puis cirer pour la scolarité suivante. Cela nous obligeait à faire attention, à ne rien renverser. Alors de là, à entailler ou graver dans les tables, il ne fallait, même pas, y songer.
On se souvient, avec le sourire, des crayons à encre, violette, dont il fallait mouiller la mine pour que l’encre marque sur le papier.
Si l’on avait pas de petite éponge à portée de mains, nous humidifions la mine avec la langue. Vous imaginez aisément la couleur de la langue après un usage assez intensif de ce crayon.
vendredi 17 avril 2009
Nos traumatismes
Rappel de nos "traumatismes"
Dates fastidieuses de notre Histoire de France
Telles, les années 800, 1515, 1789, 1805, 1809, Napoléon Bonaparte, Louis XIV, les Cents Jours, Charles X, 1848. Pour ce que cela nous sert maintenant. S’en rappelle-t-on ? J’en doute
Pour ma part pour les trois premières dates que je viens d’écrire, ça va, mais pour le reste de l’Histoire de France, ce n’est pas évident.
Les départements, à apprendre par cœur, avec les préfectures et les sous-préfectures, maintenant, il y a un code postal.
Savoir dessiner, sans modèle visuel, la carte de la France, avec ses fleuves, les grandes villes et ports principaux.( Parfois le résultat n’était pas triste.)
Dessiner de mémoire le département de la Somme avec les principales villes sous- préfectures et les gros bourgs ainsi que les principales rivières. Là, aussi, mes résultats n’étaient pas très probants. Car pour moi, le dessin et le chant étaient, et de loin, les matières pour lesquelles je n’avais pas le plus petit don. Aussi, j’avais régulièrement des notes nettement, en dessous de la moyenne.
Leçon non apprise ! Tarif de punition 3 à 5 fois à copier le texte.
Dates d’histoire, non apprises, tarif, 50 fois à copier chacune.
Quant à l’instruction civique, les maximes étaient écrites, en grosses lettres, à la craie, sur le tableau noir (ou vert) pour le lundi et y restaient parfois deux ou trois semaines. A chaque nouvelle maxime, il fallait l’écrire sur le cahier « du jour ».
Certaines maximes devaient être apprises par cœur. Encore et toujours des leçons.
Exemples :
-Bien mal acquis ne profite jamais.
-Aime ton prochain comme toi même.
-Pauvreté n’est pas vice, etc.
Et voici une pensée de notre instituteur, Monsieur Joly Ernest.
-De beaux habits coûtent chers. Mais l’eau et le savon ne coûtent presque rien.
Je ne me rappelle pas avoir vu des institutrices ou des instituteurs malades
Alors de là, à faire grève !
Certains se mettaient de la pommade dans le nez, d’autres gobaient des œufs frais, ou buvaient de l’huile de foie de morue, comme nous.
On brûlait du papier d’Arménie ou des feuilles d’eucalyptus sur le poêle « colonne » pour embaumer ou désinfecter l’atmosphère de la classe.
Dates fastidieuses de notre Histoire de France
Telles, les années 800, 1515, 1789, 1805, 1809, Napoléon Bonaparte, Louis XIV, les Cents Jours, Charles X, 1848. Pour ce que cela nous sert maintenant. S’en rappelle-t-on ? J’en doute
Pour ma part pour les trois premières dates que je viens d’écrire, ça va, mais pour le reste de l’Histoire de France, ce n’est pas évident.
Les départements, à apprendre par cœur, avec les préfectures et les sous-préfectures, maintenant, il y a un code postal.
Savoir dessiner, sans modèle visuel, la carte de la France, avec ses fleuves, les grandes villes et ports principaux.( Parfois le résultat n’était pas triste.)
Dessiner de mémoire le département de la Somme avec les principales villes sous- préfectures et les gros bourgs ainsi que les principales rivières. Là, aussi, mes résultats n’étaient pas très probants. Car pour moi, le dessin et le chant étaient, et de loin, les matières pour lesquelles je n’avais pas le plus petit don. Aussi, j’avais régulièrement des notes nettement, en dessous de la moyenne.
Leçon non apprise ! Tarif de punition 3 à 5 fois à copier le texte.
Dates d’histoire, non apprises, tarif, 50 fois à copier chacune.
Quant à l’instruction civique, les maximes étaient écrites, en grosses lettres, à la craie, sur le tableau noir (ou vert) pour le lundi et y restaient parfois deux ou trois semaines. A chaque nouvelle maxime, il fallait l’écrire sur le cahier « du jour ».
Certaines maximes devaient être apprises par cœur. Encore et toujours des leçons.
Exemples :
-Bien mal acquis ne profite jamais.
-Aime ton prochain comme toi même.
-Pauvreté n’est pas vice, etc.
Et voici une pensée de notre instituteur, Monsieur Joly Ernest.
-De beaux habits coûtent chers. Mais l’eau et le savon ne coûtent presque rien.
Je ne me rappelle pas avoir vu des institutrices ou des instituteurs malades
Alors de là, à faire grève !
Certains se mettaient de la pommade dans le nez, d’autres gobaient des œufs frais, ou buvaient de l’huile de foie de morue, comme nous.
On brûlait du papier d’Arménie ou des feuilles d’eucalyptus sur le poêle « colonne » pour embaumer ou désinfecter l’atmosphère de la classe.
jeudi 16 avril 2009
Au milieu de la cour
Au milieu de la cour, pendant les récréations, par moitié, à tour de rôle, les instituteurs, en rond, été comme hiver, surveillaient les gosses.
Rien ne leur échappait, bagarres, bousculades un peu trop violentes, ou les jeux interdits, toupies, osselets, billes, frondes, jets de boules de neige. Car la cour était recouverte de cailloux et c’était, surtout, pour éviter que ceux-ci soient mélangés avec la neige.
Les objets des délits étaient, aussitôt confisqués, les actions belliqueuses étaient, elles aussi, réprimées selon l’âge du « coupable ». Tirage d’oreilles, « bibâches » Textes à copier, ou verbes à faire aux 16 temps, surtout dans les dernières années du primaire.
Les « bibâches » , c’était le pincement, simultané, des deux joues par l’instituteur, il soulevait, le punissable et à la descente, lui collait une gifle en le lâchant.
En cours, il fallait se lever, spontanément, comme un seul homme, en silence, quand le directeur ou autre adulte pénétrait dans la classe.
Toujours, la discipline, la politesse, et le respect des autres.
Pour les chants patriotiques, aussitôt après la Libération en 1944, c’était un rituel, La Marseillaise, Le Chant du Départ, Le Chant Des Partisans, La Marche de La 2éme DB. Ces chants étaient, surtout, appris dans les dernières classes de fin d’études.
Pour la Fête des Ecoles, au début du mois de juillet, nous étions réunis autour du
Monument aux Morts, place du Maréchal Foch, où nous chantions 2 ou 3 chants patriotiques.
Puis nous étions dirigés vers le parc de La Hotoie, après une chorégraphie de masse, nous chantions de nouveau. C’était l’occasion de vérifier nos connaissances en chants patriotiques. C’était assez prenant d’entendre des centaines de gosses entonner ces chants, qui étaient au programme du Certificat d’Etudes.
Rien ne leur échappait, bagarres, bousculades un peu trop violentes, ou les jeux interdits, toupies, osselets, billes, frondes, jets de boules de neige. Car la cour était recouverte de cailloux et c’était, surtout, pour éviter que ceux-ci soient mélangés avec la neige.
Les objets des délits étaient, aussitôt confisqués, les actions belliqueuses étaient, elles aussi, réprimées selon l’âge du « coupable ». Tirage d’oreilles, « bibâches » Textes à copier, ou verbes à faire aux 16 temps, surtout dans les dernières années du primaire.
Les « bibâches » , c’était le pincement, simultané, des deux joues par l’instituteur, il soulevait, le punissable et à la descente, lui collait une gifle en le lâchant.
En cours, il fallait se lever, spontanément, comme un seul homme, en silence, quand le directeur ou autre adulte pénétrait dans la classe.
Toujours, la discipline, la politesse, et le respect des autres.
Pour les chants patriotiques, aussitôt après la Libération en 1944, c’était un rituel, La Marseillaise, Le Chant du Départ, Le Chant Des Partisans, La Marche de La 2éme DB. Ces chants étaient, surtout, appris dans les dernières classes de fin d’études.
Pour la Fête des Ecoles, au début du mois de juillet, nous étions réunis autour du
Monument aux Morts, place du Maréchal Foch, où nous chantions 2 ou 3 chants patriotiques.
Puis nous étions dirigés vers le parc de La Hotoie, après une chorégraphie de masse, nous chantions de nouveau. C’était l’occasion de vérifier nos connaissances en chants patriotiques. C’était assez prenant d’entendre des centaines de gosses entonner ces chants, qui étaient au programme du Certificat d’Etudes.
mercredi 15 avril 2009
La cantine
Je ne me souviens pas s’il y avait une restauration scolaire pendant la guerre. Mais après celle-ci, ceux qui y mangeaient devaient se rendre à l’école Saint Germain, rue Basse des Tanneurs prés de la place Vogel.
Naturellement, aller et retour à pieds, par les rues Delahaye, des Teinturiers, Baillon, etc. Par n’importe quel temps.
Toujours à cause de la maladie de mon père, je fus obligé de quitter, une fois de plus la maison familiale. J’habitais chez une cousine à Renancourt. C’était assez loin, surtout l’hiver. Puis je suis venu habiter, chez un couple, les Dupré, à 300 mètres de la maison. J’étais encore chez eux, au moment des épreuves du Certificat d’Etudes. Je fis ce parcours, vers la cantine environ 8 mois. Le parcours, nous n’y pensions pas. Pour nous, à l’époque, c’était normal, tous les déplacements, piscine de plein air, foire-exposition, cirque ou cinéma pour les fêtes de Noël, se faisaient à pieds.
Ce que l’on a pu rire, sur le chemin pour se rendre à la cantine, prés de la Place Vogel
Je me souviens avoir fait ce parcours, tous les jours avec un grand gaillard (selon moi), j’étais assez frêle et chétif à presque 14 ans et lui, plus jeune, me dépassait de presque une tête.
Ce grand gaillard était en seconde de primaire. Très sympa, toujours à raconter des histoires, des anecdotes (Vraies ou fausses ?). Son nom, je crois, était…Alexandre.
Pendant ce temps, je ne pensais pas à mes soucis, à mes problèmes familiaux.
Mon père avait eu un « chaud et froid » sur les chantiers, dans le bâtiment et voulait difficilement se soigner. De plus mon père avait fait une grande partie de le guerre 1914/1918, dans les tranchées et avait été un peu « gazé » et cela aggravait sa maladie.
Si bien qu’il fut, à son tour, atteint par la tuberculose. Il ne voulait pas aller en sanatorium ni même à l’hôpital pourtant tout proche, il voulait rester chez lui, dans la maison qu’il avait construite. Alors il fallut que je quitte la maison, pour être brinquebaler à droite comme à gauche.
Naturellement, aller et retour à pieds, par les rues Delahaye, des Teinturiers, Baillon, etc. Par n’importe quel temps.
Toujours à cause de la maladie de mon père, je fus obligé de quitter, une fois de plus la maison familiale. J’habitais chez une cousine à Renancourt. C’était assez loin, surtout l’hiver. Puis je suis venu habiter, chez un couple, les Dupré, à 300 mètres de la maison. J’étais encore chez eux, au moment des épreuves du Certificat d’Etudes. Je fis ce parcours, vers la cantine environ 8 mois. Le parcours, nous n’y pensions pas. Pour nous, à l’époque, c’était normal, tous les déplacements, piscine de plein air, foire-exposition, cirque ou cinéma pour les fêtes de Noël, se faisaient à pieds.
Ce que l’on a pu rire, sur le chemin pour se rendre à la cantine, prés de la Place Vogel
Je me souviens avoir fait ce parcours, tous les jours avec un grand gaillard (selon moi), j’étais assez frêle et chétif à presque 14 ans et lui, plus jeune, me dépassait de presque une tête.
Ce grand gaillard était en seconde de primaire. Très sympa, toujours à raconter des histoires, des anecdotes (Vraies ou fausses ?). Son nom, je crois, était…Alexandre.
Pendant ce temps, je ne pensais pas à mes soucis, à mes problèmes familiaux.
Mon père avait eu un « chaud et froid » sur les chantiers, dans le bâtiment et voulait difficilement se soigner. De plus mon père avait fait une grande partie de le guerre 1914/1918, dans les tranchées et avait été un peu « gazé » et cela aggravait sa maladie.
Si bien qu’il fut, à son tour, atteint par la tuberculose. Il ne voulait pas aller en sanatorium ni même à l’hôpital pourtant tout proche, il voulait rester chez lui, dans la maison qu’il avait construite. Alors il fallut que je quitte la maison, pour être brinquebaler à droite comme à gauche.
mardi 14 avril 2009
Un fait marquant
J’ai oublié de raconter un fait marquant.
Ce fut pendant la scolarité de 1946/1947 qu’un instituteur, Monsieur Hénaut, nous visionna des vues stéréoscopiques, en relief, sur des plaques de verre, avec un stéréoscope en bois. Monsieur Hénaut nous présentait ces vues en noir ou marron et blanc.
C’est, ainsi, que pour la première fois, nous avons vu les aiguiseurs de couteaux de Thiers. Les ouvriers étaient allongés sur le ventre pour aiguiser les couteaux, dans l’eau froide
Des chiens étaient allongés à leurs pieds et sur les côtés pour leur maintenir un peu de chaleur.
J’ai vu, aussi en relief, entre autres choses, le Cirque de Gavarnie. J’y ai pensé bien souvent et on pourrait dire que je m’étais fait la promesse d’y aller un jour. Ce fut fait, un peu tardivement, en août 1982, presque 25 ans après.
Dans cette même classe, dans les années d’après-guerre, il y avait, parfois, des séances de cinéma 8 m/m. Les vitres étaient occultées pour la circonstance.
C’étaient très souvent des films de Charlot ou de Laurel et Hardy. Parfois, quelques films de cow-boys « Canadiens » Le héros, Jim Boum ! D’où venaient ces films, Mystère !
Revenons à la classe de fin d’études et aux punitions pour faute de comportement et le tarif était très souvent le même. Un verbe à copier aux 16 temps, dans une phrase, les verbes indicatifs, présent, passé, futur, etc. les verbes conditionnels. les verbes subjonctifs, impératifs. Bref, toute la gamme et cette phrase tenait difficilement sur une ligne. Par exemple
-Je ne bouscule pas mon petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation.
-Tu ne bouscules pas ton petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation.
- Il ne bouscule pas son petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation
-Nous ne bousculons pas nos petits camarades……. !
Et les motifs ne manquaient pas.
La punition était, souvent, à rendre dans les trois jours, sinon, après le double à faire. L’instituteur avait noté les punitions pour ne pas les oublier. Alors, souvent, on passait plusieurs heures à les faire et après cela, nous savions nos conjugaisons.
Très souvent les instituteurs s’asseyaient à la dernière table au fond de la classe pour mieux nous surveiller. Rien ne pouvait leur échapper.
Pourtant ne dit-on pas que les cancres s’épanouissent au fond de la classe ?
La légende est fausse.
Si notre instituteur, Joly Ernest, très sévère, ne pouvait assurer la garde de l’étude jusqu’à 18h30 ou 18h45, pour des raisons personnelles, il emmenait les punis chez lui, au 44 de la rue de Vignacourt. Les punitions se faisaient assis sur les marches de l’escalier, sous la surveillance de son épouse. Cela ne devait pas être facile d’écrire dans de telles conditions, je suppose. Car par chance, je n’ai pas eu ce « déshonneur » vis à vis des copains.
Ce fut pendant la scolarité de 1946/1947 qu’un instituteur, Monsieur Hénaut, nous visionna des vues stéréoscopiques, en relief, sur des plaques de verre, avec un stéréoscope en bois. Monsieur Hénaut nous présentait ces vues en noir ou marron et blanc.
C’est, ainsi, que pour la première fois, nous avons vu les aiguiseurs de couteaux de Thiers. Les ouvriers étaient allongés sur le ventre pour aiguiser les couteaux, dans l’eau froide
Des chiens étaient allongés à leurs pieds et sur les côtés pour leur maintenir un peu de chaleur.
J’ai vu, aussi en relief, entre autres choses, le Cirque de Gavarnie. J’y ai pensé bien souvent et on pourrait dire que je m’étais fait la promesse d’y aller un jour. Ce fut fait, un peu tardivement, en août 1982, presque 25 ans après.
Dans cette même classe, dans les années d’après-guerre, il y avait, parfois, des séances de cinéma 8 m/m. Les vitres étaient occultées pour la circonstance.
C’étaient très souvent des films de Charlot ou de Laurel et Hardy. Parfois, quelques films de cow-boys « Canadiens » Le héros, Jim Boum ! D’où venaient ces films, Mystère !
Revenons à la classe de fin d’études et aux punitions pour faute de comportement et le tarif était très souvent le même. Un verbe à copier aux 16 temps, dans une phrase, les verbes indicatifs, présent, passé, futur, etc. les verbes conditionnels. les verbes subjonctifs, impératifs. Bref, toute la gamme et cette phrase tenait difficilement sur une ligne. Par exemple
-Je ne bouscule pas mon petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation.
-Tu ne bouscules pas ton petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation.
- Il ne bouscule pas son petit camarade dans la cour de l’école pendant la récréation
-Nous ne bousculons pas nos petits camarades……. !
Et les motifs ne manquaient pas.
La punition était, souvent, à rendre dans les trois jours, sinon, après le double à faire. L’instituteur avait noté les punitions pour ne pas les oublier. Alors, souvent, on passait plusieurs heures à les faire et après cela, nous savions nos conjugaisons.
Très souvent les instituteurs s’asseyaient à la dernière table au fond de la classe pour mieux nous surveiller. Rien ne pouvait leur échapper.
Pourtant ne dit-on pas que les cancres s’épanouissent au fond de la classe ?
La légende est fausse.
Si notre instituteur, Joly Ernest, très sévère, ne pouvait assurer la garde de l’étude jusqu’à 18h30 ou 18h45, pour des raisons personnelles, il emmenait les punis chez lui, au 44 de la rue de Vignacourt. Les punitions se faisaient assis sur les marches de l’escalier, sous la surveillance de son épouse. Cela ne devait pas être facile d’écrire dans de telles conditions, je suppose. Car par chance, je n’ai pas eu ce « déshonneur » vis à vis des copains.
lundi 13 avril 2009
Années 1947-1949
Dans les années de 1947 à 1949, un instituteur, Monsieur Poignant, avait créé, à l’école Zamenhof, une section d’Eclaireurs de France, forme de scoutisme laïque de l’Education Nationale.
Ces « Eclaireurs » partaient, à pieds, le samedi, en fin d’après-midi, tirant une petite voiturette, elle même, transportant tout le matériel pour camper, tente, couchage, ustensiles de cuisine, etc. Ce n’était pas le matériel, ultra léger que l’on connaît actuellement.
Campant une nuit ou deux, dans les bois aux alentours de Flesselles ou d’Allonville, ils revenaient vers Amiens, le dimanche ou le lundi soir, selon les fêtes ou autres.
Ils cuisinaient sur un feu de bois, entre de grosses pierres avec des faitouts qu’il fallait récurer, surtout l’extérieur, avant de rentrer.
En 1947, suite aux grèves, dans les mines du Nord et du Pas de Calais, qui perdurèrent bien longtemps, la vie des familles de ces régions fut difficile financièrement.
Ces grèves, fomentées par le Parti Communiste, espérant prendre le pouvoir, obligèrent les enfants à partir dans d’autres départements limitrophes et étaient placés dans des familles sympathisantes.
C’est ainsi que les écoles de Saint Maurice, garçons et filles, accueillirent des enfants du Nord et du Pas de Calais, gonflant les effectifs, déjà bien chargés
Je ne me souviens plus combien de temps dura cette situation.
La seule piscine municipale, de plein air « Le Bain de Sable » prés du pont Beauvillé, ouvrait du 15 juin au 15 septembre. Mais l’ouverture et la fermeture étaient tributaires du temps. L’eau du « Bain de Sable » venait des Hortillonnages, vaguement filtrée, en amont, par un apport de chlore, et s’écoulait au travers de la piscine avant de se déverser peu après dans la Somme à proximité.
Notre instituteur, Joly Ernest, avait, en accord avec les maîtres-nageurs de l’époque, des méthodes fermes, efficaces, autoritaires pour apprendre à nager aux élèves. Ayant beaucoup d’autorité et aidé par les maîtres-nageurs, l’instituteur apprenait aux jeunes à nager en 5 ou 6 leçons maximum, surtout, comme je l’ai, déjà, souligné, nous quittions l’école vers le 14 Juillet. Mais les étés, de cette époque là, étaient meilleurs qu’actuellement.
Les maîtres-nageurs de l’époque étaient Messieurs Réveillon, Mercier, Loyer puis l’année suivante Messieurs Burnay et Farcy.
Monsieur Burnay, originaire de notre quartier, devint, par la suite, directeur de la patinoire et de la piscine Pierre de Coubertin à Amiens.
Naturellement, nous allions à cette piscine de plein air, « Le Bain de Sable » à pieds. Celle-ci ouvrait à 15 heures, et de retour à l’école vers 16heures 30, on continuait les cours jusqu’à 18 heures 30. Le matin, nous devions nous rendre à cette piscine pour 10 heures 30 et être de retour vers 12 heures, pour ceux qui devaient aller, aussi, à la cantine, encore et toujours à pieds.
Selon les jours, l’eau de la piscine n’était pas très chaude, le matin vers 11 heures.
Une autre piscine privée, de plein air, « l’Ile aux Fagots », était située le long du chemin de halage, en amont d’Amiens, mais l’eau, aussi, des Hortillonnages, était peu filtrée, par des fagots de bois plantés dans l’eau et la vase. Les cabines étaient sur des pontons en bois
Les waters étaient situés en aval, dans le très vague courant de l’eau venant des étangs aux alentours. Parfois le courant devenait contraire, vous imaginez, aisément, la pureté de l’eau.
Ces « Eclaireurs » partaient, à pieds, le samedi, en fin d’après-midi, tirant une petite voiturette, elle même, transportant tout le matériel pour camper, tente, couchage, ustensiles de cuisine, etc. Ce n’était pas le matériel, ultra léger que l’on connaît actuellement.
Campant une nuit ou deux, dans les bois aux alentours de Flesselles ou d’Allonville, ils revenaient vers Amiens, le dimanche ou le lundi soir, selon les fêtes ou autres.
Ils cuisinaient sur un feu de bois, entre de grosses pierres avec des faitouts qu’il fallait récurer, surtout l’extérieur, avant de rentrer.
En 1947, suite aux grèves, dans les mines du Nord et du Pas de Calais, qui perdurèrent bien longtemps, la vie des familles de ces régions fut difficile financièrement.
Ces grèves, fomentées par le Parti Communiste, espérant prendre le pouvoir, obligèrent les enfants à partir dans d’autres départements limitrophes et étaient placés dans des familles sympathisantes.
C’est ainsi que les écoles de Saint Maurice, garçons et filles, accueillirent des enfants du Nord et du Pas de Calais, gonflant les effectifs, déjà bien chargés
Je ne me souviens plus combien de temps dura cette situation.
La seule piscine municipale, de plein air « Le Bain de Sable » prés du pont Beauvillé, ouvrait du 15 juin au 15 septembre. Mais l’ouverture et la fermeture étaient tributaires du temps. L’eau du « Bain de Sable » venait des Hortillonnages, vaguement filtrée, en amont, par un apport de chlore, et s’écoulait au travers de la piscine avant de se déverser peu après dans la Somme à proximité.
Notre instituteur, Joly Ernest, avait, en accord avec les maîtres-nageurs de l’époque, des méthodes fermes, efficaces, autoritaires pour apprendre à nager aux élèves. Ayant beaucoup d’autorité et aidé par les maîtres-nageurs, l’instituteur apprenait aux jeunes à nager en 5 ou 6 leçons maximum, surtout, comme je l’ai, déjà, souligné, nous quittions l’école vers le 14 Juillet. Mais les étés, de cette époque là, étaient meilleurs qu’actuellement.
Les maîtres-nageurs de l’époque étaient Messieurs Réveillon, Mercier, Loyer puis l’année suivante Messieurs Burnay et Farcy.
Monsieur Burnay, originaire de notre quartier, devint, par la suite, directeur de la patinoire et de la piscine Pierre de Coubertin à Amiens.
Naturellement, nous allions à cette piscine de plein air, « Le Bain de Sable » à pieds. Celle-ci ouvrait à 15 heures, et de retour à l’école vers 16heures 30, on continuait les cours jusqu’à 18 heures 30. Le matin, nous devions nous rendre à cette piscine pour 10 heures 30 et être de retour vers 12 heures, pour ceux qui devaient aller, aussi, à la cantine, encore et toujours à pieds.
Selon les jours, l’eau de la piscine n’était pas très chaude, le matin vers 11 heures.
Une autre piscine privée, de plein air, « l’Ile aux Fagots », était située le long du chemin de halage, en amont d’Amiens, mais l’eau, aussi, des Hortillonnages, était peu filtrée, par des fagots de bois plantés dans l’eau et la vase. Les cabines étaient sur des pontons en bois
Les waters étaient situés en aval, dans le très vague courant de l’eau venant des étangs aux alentours. Parfois le courant devenait contraire, vous imaginez, aisément, la pureté de l’eau.
dimanche 12 avril 2009
Scolarité 1947-1948
Pendant la scolarité 1947/1948, l’instituteur Joly Ernest, qui commençait pour la première fois, sa classe de fin d’études, présenta, à la fin de celle-ci, 21 élèves au Certificat d’Etudes, 19 furent reçus, dont les premier, deuxième, troisième et cinquième du canton.
Les élèves étaient classés, selon leur moyenne obtenue à cet examen. C’était un honneur, pour l’instituteur et pour l’école que d’être dans les cinq premiers.
Il faut, bien l’avouer, que dans cette scolarité, il y avait des gars exceptionnels, Michel Objois, Jacques Boulanger, Serge Lefebvre, Grenon ?
A la fin des scolarités dans le courant du mois des mois de mai ou de juin, Joly Ernest faisait passer, en blanc, l’examen des concours d’entrée aux différentes écoles secondaires. Ces examens avaient été proposés les années précédentes.
Puis il présentait les meilleurs à ces concours d’entrée.
Société Industrielle, rue Alexandre Fatton.
Centre d’apprentissage de la SNCF, rue de la Délivrance
Lycée
Ecole des Beaux Arts, rue Desprez Si doué pour cela, ( pas moi ).
A charge aux parents d’envoyer leur enfant dans le secondaire de leur choix, s’il avait réussi le concours d’entrée.
Comme je l’écris, par ailleurs, mon père m’avait reconstitué un vélo avec des pièces récupérées à droite et à gauche. A l’âge de 11/12 ans, j’étais, toujours, sur ma bicyclette. Très gosse, très amusette, j’essayais de conjurer, d’oublier les maladies que j’avais subi.
Aussi, l’instituteur Joly Ernest avait dit à mon père ;
Donnez moi le vélo de votre fils, je le mettrais dans mon grenier, sans cela il n’aura, jamais son certificat d’études.
Au cours de l’hiver 1947/1948, annonce d’une grève générale pour les institutrices et les instituteurs et notre magister annonça :
Nous ne faisons pas grève demain.
Le lendemain tous les enseignants et les élèves étaient présents. Sauf trois copains de notre classe. Claude Houbart, Michel Objois et Claude Canchon.
Vers 9 heures, le directeur, Monsieur Homet, vint pour nous surveiller, pendant que notre instituteur s’absentait. Et il revint, peu après, avec les deux premiers élèves, cités ci-dessus.
La tête basse, ils reprirent les cours normalement, l’instituteur était allé les surprendre chez l’un deux, en train de lire des bandes dessinées, au coin du feu. Il y eut des punitions accordées, certainement, mais je ne m’en souviens plus.
Vers 10 heures 30, la porte de la classe s’ouvrit avec fracas, Claude Canchon, fut projeté sur la dernière table, juste derrière moi, par son père, qui colla une sévère raclée, à son fils, devant nous.
Les élèves étaient classés, selon leur moyenne obtenue à cet examen. C’était un honneur, pour l’instituteur et pour l’école que d’être dans les cinq premiers.
Il faut, bien l’avouer, que dans cette scolarité, il y avait des gars exceptionnels, Michel Objois, Jacques Boulanger, Serge Lefebvre, Grenon ?
A la fin des scolarités dans le courant du mois des mois de mai ou de juin, Joly Ernest faisait passer, en blanc, l’examen des concours d’entrée aux différentes écoles secondaires. Ces examens avaient été proposés les années précédentes.
Puis il présentait les meilleurs à ces concours d’entrée.
Société Industrielle, rue Alexandre Fatton.
Centre d’apprentissage de la SNCF, rue de la Délivrance
Lycée
Ecole des Beaux Arts, rue Desprez Si doué pour cela, ( pas moi ).
A charge aux parents d’envoyer leur enfant dans le secondaire de leur choix, s’il avait réussi le concours d’entrée.
Comme je l’écris, par ailleurs, mon père m’avait reconstitué un vélo avec des pièces récupérées à droite et à gauche. A l’âge de 11/12 ans, j’étais, toujours, sur ma bicyclette. Très gosse, très amusette, j’essayais de conjurer, d’oublier les maladies que j’avais subi.
Aussi, l’instituteur Joly Ernest avait dit à mon père ;
Donnez moi le vélo de votre fils, je le mettrais dans mon grenier, sans cela il n’aura, jamais son certificat d’études.
Au cours de l’hiver 1947/1948, annonce d’une grève générale pour les institutrices et les instituteurs et notre magister annonça :
Nous ne faisons pas grève demain.
Le lendemain tous les enseignants et les élèves étaient présents. Sauf trois copains de notre classe. Claude Houbart, Michel Objois et Claude Canchon.
Vers 9 heures, le directeur, Monsieur Homet, vint pour nous surveiller, pendant que notre instituteur s’absentait. Et il revint, peu après, avec les deux premiers élèves, cités ci-dessus.
La tête basse, ils reprirent les cours normalement, l’instituteur était allé les surprendre chez l’un deux, en train de lire des bandes dessinées, au coin du feu. Il y eut des punitions accordées, certainement, mais je ne m’en souviens plus.
Vers 10 heures 30, la porte de la classe s’ouvrit avec fracas, Claude Canchon, fut projeté sur la dernière table, juste derrière moi, par son père, qui colla une sévère raclée, à son fils, devant nous.
samedi 11 avril 2009
Pardon, ch’Nesse
Circulant dans un fourgon de police, le père étant flic, vit son fils, déambulant, en centre ville, les mains dans les poches, regardant les vitrines. Lui collant une première raclée dans le panier à salade, il le ramena, manu militari, à l’école.
Je ne me souviens pas des punitions que Claude a pu avoir (certainement ces fameux verbes), mais cela ne dut pas être triste.
Un jour en rentrant en classe à 14 heures :
- Messieurs, asseyez-vous, Messieurs FL et JN restez debout
- Vous vous appelez comment ?
- FL
- Et vous ?
- JN
- Quand vous êtes nés, vous avez donné votre avis pour avoir votre prénom ?
- Non…Non
- Alors, moi, mon prénom est Ernest, je n’y suis pour rien. Mes parents m’ont donné ce prénom, et j’en suis fier !
Il s’en suivi d’un long sermon sur le sujet, leur comportement, et de paroles prononcées.
En écoutant ce sermon, les deux copains pleuraient, jurant que l’on ne les y reprendrait plus. Nous mêmes, nous n’en menions pas large, pas fiers du tout. Nous étions tous confus.
Dans la rue, des jeunes avaient interpellé notre instituteur, avec une chanson que nous avions composée. ( plutôt une litanie ) :
« Nénesse, il a du poil aux fesses
-Il en a plein son pantalon
-Même quand il va à la messe
-Il a l’air d’un con »
Ce n’était pas très fin, nous n’aurions pas gagné avec cette chanson, le concours de l’Eurovision, s’il avait existé. Mais nous n’avions pas 14 ans, et comme tous les gosses, de cet âge là, nous étions assez médisants ou méchants.
Pardon, ch’Nesse, Nessie pour sa femme.
Je ne me souviens pas des punitions que Claude a pu avoir (certainement ces fameux verbes), mais cela ne dut pas être triste.
Un jour en rentrant en classe à 14 heures :
- Messieurs, asseyez-vous, Messieurs FL et JN restez debout
- Vous vous appelez comment ?
- FL
- Et vous ?
- JN
- Quand vous êtes nés, vous avez donné votre avis pour avoir votre prénom ?
- Non…Non
- Alors, moi, mon prénom est Ernest, je n’y suis pour rien. Mes parents m’ont donné ce prénom, et j’en suis fier !
Il s’en suivi d’un long sermon sur le sujet, leur comportement, et de paroles prononcées.
En écoutant ce sermon, les deux copains pleuraient, jurant que l’on ne les y reprendrait plus. Nous mêmes, nous n’en menions pas large, pas fiers du tout. Nous étions tous confus.
Dans la rue, des jeunes avaient interpellé notre instituteur, avec une chanson que nous avions composée. ( plutôt une litanie ) :
« Nénesse, il a du poil aux fesses
-Il en a plein son pantalon
-Même quand il va à la messe
-Il a l’air d’un con »
Ce n’était pas très fin, nous n’aurions pas gagné avec cette chanson, le concours de l’Eurovision, s’il avait existé. Mais nous n’avions pas 14 ans, et comme tous les gosses, de cet âge là, nous étions assez médisants ou méchants.
Pardon, ch’Nesse, Nessie pour sa femme.
vendredi 10 avril 2009
Trois anecdotes
Voici trois anecdotes pour justifier la sévérité des parents, du moins pour moi, vis à vis de l’instruction et de l’école : Devoirs, Leçons, Résultats et présence en cours.
1. Pendant ma scolarité 1947/1948, avec des copains, nous allions très souvent dans un bosquet situé dans le quartier, près du cimetière de la Madeleine.
En grimpant sur un arbre, je suis tombé dans le vide, les épaules touchant le sol, mais je restais suspendu par une fesse à un crochet fixé au bout d’une corde un peu courte. Les copains m’ont décroché. Et je suis revenu avec des difficultés, saignant pas mal, vers chez moi, soutenu par les épaules par deux copains. Une riveraine et sa mère , sur mon chemin, rue Gutemberg m’ont nettoyé un peu la plaie et mis un bandage pour comprimer un peu la plaie.
J’en ai gardé une belle cicatrice derrière la fesse droite
Naturellement au retour, difficile, à la maison, eng…ades sévères par ma mère. Je me suis dit :
-Je ne peux pas marcher, demain et les jours suivants, chouette, pas d’école !
C’était mal connaître ma mère. Très sévère pour tout ce qui touchait l’école. Celle-ci avait une ancienne copine qui habitait à cent mètres de l’école. Ma mère me conduisait à l’école le matin, dans une voiturette ( faite avec des roues de vélos, comme on en voyait beaucoup à l’époque ) et venait me rechercher le soir vers 18 heures 45. Et suprême honte, le matin, nous passions devant l’école des filles
Le midi, deux copains me portaient par les épaules pour que j’aille déjeuner chez l’amie de ma mère et me reprenaient pour le retour à l’école vers 14 heures et ce manège dura une semaine.
2. Un soir de l’hiver 1948 /1949, en sortant de l’école vers 18 heures 30, je me suis
blessé au poignet droit en tombant dans des circonstances que je ne veux pas narrer. Après un pansement sommaire chez des amis de mes parents et de retour à la maison un peu après, j’eus encore droit à des reproches sévères de mes parents.
Le lendemain matin, ma mère et moi montions à l’hôpital pour me faire poser des
points de suture, sous anesthésie générale, ( au chloroforme, c’est vraiment dégueulasse ) et je suis sorti de l’hôpital, le soir même :
- Chouette ! Je ne peux pas écrire, alors pas d’école !
Résultat, mon père a décrété :
-Tu ne peux pas écrire mais tu peux écouter ou apprendre des leçons, alors direction l’école.
3. Quand nous avions à faire une dictée classique ou une dictée de mots difficiles, celles-ci avaient toujours lieu, en ce moment là, au début d’après-midi dans cette même scolarité de 1948/1949. Pendant que nous écrivions, l’instituteur passait dans les allées en dictant et surveillait en même temps nos écrits.
Assis à la droite de la table, j’avais certainement écrit une faute trop flagrante, Joly Ernest en passant, près de moi, me colla un genre de pichenette du revers de la main, derrière l’oreille droite.
Je poussais un hurlement de douleur et le sang se mit à couler derrière mon oreille.
Celui-ci coulait pas mal et tout le monde était paniqué, même moi, un peu impressionné. On m’accompagna chez Madame Hénaut, qui faisait office de soignante ou d’infirmière pour les petits maux. Le directeur vint aux nouvelles.
Avec des pansements, le saignement s’arrêta et on me mit un bandage autour de la tête, on me nettoya un peu les habits du sang qui avait coulait dessus et je repris les cours jusqu’au soir.
L’instituteur me fit une lettre, cachetée, d’excuses que je remis à mes parents le soir même. Ma mère était présente, ainsi que mon père quand je suis rentré, un pansement autour de la tète. Ma mère était confectionneuse à domicile et mon père malade depuis quelques mois, était en longue maladie.
Ma mère était atterrée de me voir avec un pareil pansement. Mon père prit la lettre d’excuses de l’instituteur et après la lecture de cette dernière me fit ce simple commentaire :
-Ne viens pas te plaindre, sinon je t’en colle autant de l’autre côté !
Essayez de vous plaindre, de vous faire consoler. L’instituteur avait toujours raison (du moins avec mes parents).
Ce serait actuellement, à l’époque actuelle, en 2008, quel scandale ! Avec des articles dans les journaux, avec des propos sévères des parents ou des associations de parents d’élèves.
Mais en ces moments là, « Motus »
1. Pendant ma scolarité 1947/1948, avec des copains, nous allions très souvent dans un bosquet situé dans le quartier, près du cimetière de la Madeleine.
En grimpant sur un arbre, je suis tombé dans le vide, les épaules touchant le sol, mais je restais suspendu par une fesse à un crochet fixé au bout d’une corde un peu courte. Les copains m’ont décroché. Et je suis revenu avec des difficultés, saignant pas mal, vers chez moi, soutenu par les épaules par deux copains. Une riveraine et sa mère , sur mon chemin, rue Gutemberg m’ont nettoyé un peu la plaie et mis un bandage pour comprimer un peu la plaie.
J’en ai gardé une belle cicatrice derrière la fesse droite
Naturellement au retour, difficile, à la maison, eng…ades sévères par ma mère. Je me suis dit :
-Je ne peux pas marcher, demain et les jours suivants, chouette, pas d’école !
C’était mal connaître ma mère. Très sévère pour tout ce qui touchait l’école. Celle-ci avait une ancienne copine qui habitait à cent mètres de l’école. Ma mère me conduisait à l’école le matin, dans une voiturette ( faite avec des roues de vélos, comme on en voyait beaucoup à l’époque ) et venait me rechercher le soir vers 18 heures 45. Et suprême honte, le matin, nous passions devant l’école des filles
Le midi, deux copains me portaient par les épaules pour que j’aille déjeuner chez l’amie de ma mère et me reprenaient pour le retour à l’école vers 14 heures et ce manège dura une semaine.
2. Un soir de l’hiver 1948 /1949, en sortant de l’école vers 18 heures 30, je me suis
blessé au poignet droit en tombant dans des circonstances que je ne veux pas narrer. Après un pansement sommaire chez des amis de mes parents et de retour à la maison un peu après, j’eus encore droit à des reproches sévères de mes parents.
Le lendemain matin, ma mère et moi montions à l’hôpital pour me faire poser des
points de suture, sous anesthésie générale, ( au chloroforme, c’est vraiment dégueulasse ) et je suis sorti de l’hôpital, le soir même :
- Chouette ! Je ne peux pas écrire, alors pas d’école !
Résultat, mon père a décrété :
-Tu ne peux pas écrire mais tu peux écouter ou apprendre des leçons, alors direction l’école.
3. Quand nous avions à faire une dictée classique ou une dictée de mots difficiles, celles-ci avaient toujours lieu, en ce moment là, au début d’après-midi dans cette même scolarité de 1948/1949. Pendant que nous écrivions, l’instituteur passait dans les allées en dictant et surveillait en même temps nos écrits.
Assis à la droite de la table, j’avais certainement écrit une faute trop flagrante, Joly Ernest en passant, près de moi, me colla un genre de pichenette du revers de la main, derrière l’oreille droite.
Je poussais un hurlement de douleur et le sang se mit à couler derrière mon oreille.
Celui-ci coulait pas mal et tout le monde était paniqué, même moi, un peu impressionné. On m’accompagna chez Madame Hénaut, qui faisait office de soignante ou d’infirmière pour les petits maux. Le directeur vint aux nouvelles.
Avec des pansements, le saignement s’arrêta et on me mit un bandage autour de la tête, on me nettoya un peu les habits du sang qui avait coulait dessus et je repris les cours jusqu’au soir.
L’instituteur me fit une lettre, cachetée, d’excuses que je remis à mes parents le soir même. Ma mère était présente, ainsi que mon père quand je suis rentré, un pansement autour de la tète. Ma mère était confectionneuse à domicile et mon père malade depuis quelques mois, était en longue maladie.
Ma mère était atterrée de me voir avec un pareil pansement. Mon père prit la lettre d’excuses de l’instituteur et après la lecture de cette dernière me fit ce simple commentaire :
-Ne viens pas te plaindre, sinon je t’en colle autant de l’autre côté !
Essayez de vous plaindre, de vous faire consoler. L’instituteur avait toujours raison (du moins avec mes parents).
Ce serait actuellement, à l’époque actuelle, en 2008, quel scandale ! Avec des articles dans les journaux, avec des propos sévères des parents ou des associations de parents d’élèves.
Mais en ces moments là, « Motus »
jeudi 9 avril 2009
Adolescents sportifs
Les adolescents de notre époque étaient plus « sportifs » que maintenant. Par la force des choses. Que faire d’autres ? Pas de radios portables, pas d’équipements sportifs. Quand on se réunissait, on faisait un petit match de football, à 3 ou 4 contre 4 ou 5 sur une vague place, un petit terrain ou contre un mur. Malheur aux chaussures personnelles !
L’été, beaucoup de natation dans la Somme, propre en ce temps là, mais c’était interdit quand même. Peu de copains avaient un vélo, même, retapé, reconstitué. On recevais un vélo, quand on réussissait l’épreuve du Certificat d’Etudes, ou que l’on commençait à travailler vers 14 ans, en général, dans les industries textiles ou dans des garages.
Les loisirs, après la guerre, étaient le cinéma, peu cher, dans les cinémas de quartiers,
Une dizaine en tout dans Amiens. Plus les salles paroissiales (3 ou 4) Dans le centre de la Ville, il y avait des salles de cinéma un peu plus huppées que celles des quartiers périphériques.
Pour ceux qui aimaient la lecture, peu de bandes dessinées, mais des auteurs classiques, habituels, Jules Verne, Paul Féval, Edgar Poë, Alexandre Dumas, Pierre Loti, etc. que nous pouvions prendre dans la bibliothèque de la classe.
Balades à pieds avec les parents, ou nous les accompagnions au jardin. Surtout pendant la guerre et on ne pouvait guère quitter Saint Maurice ou ses environs vers le Nord, notre quartier était considéré en Zone Interdite ! Pour passer sur le pont Cagnard, sur le Pont Neuf, près de la place Vogel, sur les ponts aux alentours de la Citadelle, il fallait un laisse-passer ( Ausweiss ) pour les adultes. Quant aux vacances, à la campagne, il était difficile de circuler avec des contrôles de gendarmerie incessants contre le ravitaillement clandestin.
Pour essayer de se rendre à la mer, il était, déjà, difficile de circuler, alors pour approcher des plages, il ne fallait pas y penser, c’était strictement interdit, (Verboten)
Bien après la Libération de la France, les moyens de locomotion étaient très limités et les plages, les blockhaus, les dunes n’étaient pas déminés.
Les adultes n’avaient que deux semaines de vacances, en général, la première quinzaine d’août et reprenaient leur travail, après le 15 du mois. Les jeunes, de 18 à 21 ans qui travaillaient, avaient droit à 3 semaines de vacances et les moins de 18 ans, 4 semaines.
Les adultes n’ayant que ces deux semaines de congés, en profitaient pour essayer de réaliser un peu de travaux dans leur maison, s’ils avaient réussi à se procurer des matériaux, très rares, avec les rationnements. Ceux-ci durèrent bien longtemps après la fin de la guerre.
Peu de gens se déplaçaient, les temps étaient extrêmement durs pour le ravitaillement, on manquait de tout, et le peu, que nos parents trouvaient, était cher, dans nos quartiers populaires, qui ont beaucoup souffert de cette maudite guerre.
L’été, beaucoup de natation dans la Somme, propre en ce temps là, mais c’était interdit quand même. Peu de copains avaient un vélo, même, retapé, reconstitué. On recevais un vélo, quand on réussissait l’épreuve du Certificat d’Etudes, ou que l’on commençait à travailler vers 14 ans, en général, dans les industries textiles ou dans des garages.
Les loisirs, après la guerre, étaient le cinéma, peu cher, dans les cinémas de quartiers,
Une dizaine en tout dans Amiens. Plus les salles paroissiales (3 ou 4) Dans le centre de la Ville, il y avait des salles de cinéma un peu plus huppées que celles des quartiers périphériques.
Pour ceux qui aimaient la lecture, peu de bandes dessinées, mais des auteurs classiques, habituels, Jules Verne, Paul Féval, Edgar Poë, Alexandre Dumas, Pierre Loti, etc. que nous pouvions prendre dans la bibliothèque de la classe.
Balades à pieds avec les parents, ou nous les accompagnions au jardin. Surtout pendant la guerre et on ne pouvait guère quitter Saint Maurice ou ses environs vers le Nord, notre quartier était considéré en Zone Interdite ! Pour passer sur le pont Cagnard, sur le Pont Neuf, près de la place Vogel, sur les ponts aux alentours de la Citadelle, il fallait un laisse-passer ( Ausweiss ) pour les adultes. Quant aux vacances, à la campagne, il était difficile de circuler avec des contrôles de gendarmerie incessants contre le ravitaillement clandestin.
Pour essayer de se rendre à la mer, il était, déjà, difficile de circuler, alors pour approcher des plages, il ne fallait pas y penser, c’était strictement interdit, (Verboten)
Bien après la Libération de la France, les moyens de locomotion étaient très limités et les plages, les blockhaus, les dunes n’étaient pas déminés.
Les adultes n’avaient que deux semaines de vacances, en général, la première quinzaine d’août et reprenaient leur travail, après le 15 du mois. Les jeunes, de 18 à 21 ans qui travaillaient, avaient droit à 3 semaines de vacances et les moins de 18 ans, 4 semaines.
Les adultes n’ayant que ces deux semaines de congés, en profitaient pour essayer de réaliser un peu de travaux dans leur maison, s’ils avaient réussi à se procurer des matériaux, très rares, avec les rationnements. Ceux-ci durèrent bien longtemps après la fin de la guerre.
Peu de gens se déplaçaient, les temps étaient extrêmement durs pour le ravitaillement, on manquait de tout, et le peu, que nos parents trouvaient, était cher, dans nos quartiers populaires, qui ont beaucoup souffert de cette maudite guerre.
mercredi 8 avril 2009
Après la guerre
Aussitôt après la guerre, il n’y avait pas de centre de loisirs, dans les quartiers, pour s’occuper des jeunes enfants, le jeudi ou pendant les vacances scolaires.
Aussi, les enfants avaient la possibilité de fréquenter un des trois patronages du quartier Saint Maurice.
Un, catholique, rue Bizet, pour les filles, chez les Sœurs de Saint Vincent de Paul.
Un, lui aussi, catholique, pour les garçons. Ce patronage était à l’emplacement des « Télécoms » actuels, mais l’entrée se faisait au 18 rue Saint Maurice
Et enfin un patronage mixte, laïque, rue Cagnard, dans l’école des filles. Dans cette école, il y a un très grand préau, couvert et fermé.
Ce patronage laïque, mixte, occupait les enfants pour des vacances scolaires de juillet, août et septembre. Avec quelques surveillants (hommes et femmes) il était dirigé par Monsieur Bec.
J’y suis allé peu. Ce que je n’aimais pas, quand j’y allais, c’était l’appel, 4 fois par jour
Après la guerre, il y avait, aussi, des colonies de vacances, académiques, municipales ou d’entreprises. Criel, Fort Mahon, Dury, Monsures, etc.
Ces colonies étaient, relativement chères, pour les enfants « uniques », beaucoup moins pour les familles nombreuses.
Au cours des scolarités 1947/48 et 1948/49 notre instituteur, Joly Ernest, quoique très sévère, fit beaucoup de bien pour les familles du quartier Saint Maurice.
Il écrivit à de nombreuses ambassades étrangères à Paris, ainsi qu’à des ambassades Françaises à l’étranger, dans les pays n’ayant pas souffert de la guerre sur leur territoire, la Suisse, la Suède, etc. et dans des pays, amis de la France, Canada, Etats Unis, Australie…..
Notre instituteur demandait des aides pour les élèves des deux écoles (filles et garçons) de Saint Maurice, car celles-ci avaient accueilli beaucoup d’élèves déplacés.
Les aides, les dons arrivèrent par centaines de kilos, je n’ose pas dire par tonnes.
Conserves de lait en poudre.
De grandes boites de fromages divers
De la confiture en boites
Des œufs en poudre.
Des boites de conserve de toutes sortes
Des vêtements chauds, surtout ( pulls, cache-nez , bonnets, chaussettes etc. )
Chaque classe (garçons ou filles ) ou chaque famille reçut, ainsi, plusieurs colis.
Cela fut un bien pour tous, car les temps de rationnement étaient durs pour chacun, après la guerre dans notre quartier et cela dura bien longtemps.
Un lingot d’argent fut même, offert à l’école par un généreux donateur Suisse, Monsieur Schaërer, (J’espère avoir bien orthographié ce nom)
Ce dernier fut invité, avec honneur, par la Municipalité Amiénoise de ces moments là, pour le remercier de tous ses dons.
Dés la première année, à tous ceux qui nous avaient aidé par leurs dons, nous nous devions de les remercier chaleureusement.
L’instituteur avait écrit divers modèles de lettres de remerciements et j’étais chargé de les recopier selon ses indications.
A l’époque j’avais une assez belle écriture, à la plume. J’en ai passé des heures à recopier ces lettres, mais j’avais encore toute l’année suivante à rester dans cette classe de fin d’études, jusqu’aux épreuves du Certificat d’Etudes.
L’année suivante, ce ne fut plus moi qui écrivit ces lettres de remerciements, mais un copain de la classe, Marc Routier, qui avait un bon coup de crayon, dessina plusieurs fois notre école, et la Cathédrale d’Amiens. Ces dessins furent joints à certaines lettres de remerciements, aux généreux donateurs.
Aussi, les enfants avaient la possibilité de fréquenter un des trois patronages du quartier Saint Maurice.
Un, catholique, rue Bizet, pour les filles, chez les Sœurs de Saint Vincent de Paul.
Un, lui aussi, catholique, pour les garçons. Ce patronage était à l’emplacement des « Télécoms » actuels, mais l’entrée se faisait au 18 rue Saint Maurice
Et enfin un patronage mixte, laïque, rue Cagnard, dans l’école des filles. Dans cette école, il y a un très grand préau, couvert et fermé.
Ce patronage laïque, mixte, occupait les enfants pour des vacances scolaires de juillet, août et septembre. Avec quelques surveillants (hommes et femmes) il était dirigé par Monsieur Bec.
J’y suis allé peu. Ce que je n’aimais pas, quand j’y allais, c’était l’appel, 4 fois par jour
Après la guerre, il y avait, aussi, des colonies de vacances, académiques, municipales ou d’entreprises. Criel, Fort Mahon, Dury, Monsures, etc.
Ces colonies étaient, relativement chères, pour les enfants « uniques », beaucoup moins pour les familles nombreuses.
Au cours des scolarités 1947/48 et 1948/49 notre instituteur, Joly Ernest, quoique très sévère, fit beaucoup de bien pour les familles du quartier Saint Maurice.
Il écrivit à de nombreuses ambassades étrangères à Paris, ainsi qu’à des ambassades Françaises à l’étranger, dans les pays n’ayant pas souffert de la guerre sur leur territoire, la Suisse, la Suède, etc. et dans des pays, amis de la France, Canada, Etats Unis, Australie…..
Notre instituteur demandait des aides pour les élèves des deux écoles (filles et garçons) de Saint Maurice, car celles-ci avaient accueilli beaucoup d’élèves déplacés.
Les aides, les dons arrivèrent par centaines de kilos, je n’ose pas dire par tonnes.
Conserves de lait en poudre.
De grandes boites de fromages divers
De la confiture en boites
Des œufs en poudre.
Des boites de conserve de toutes sortes
Des vêtements chauds, surtout ( pulls, cache-nez , bonnets, chaussettes etc. )
Chaque classe (garçons ou filles ) ou chaque famille reçut, ainsi, plusieurs colis.
Cela fut un bien pour tous, car les temps de rationnement étaient durs pour chacun, après la guerre dans notre quartier et cela dura bien longtemps.
Un lingot d’argent fut même, offert à l’école par un généreux donateur Suisse, Monsieur Schaërer, (J’espère avoir bien orthographié ce nom)
Ce dernier fut invité, avec honneur, par la Municipalité Amiénoise de ces moments là, pour le remercier de tous ses dons.
Dés la première année, à tous ceux qui nous avaient aidé par leurs dons, nous nous devions de les remercier chaleureusement.
L’instituteur avait écrit divers modèles de lettres de remerciements et j’étais chargé de les recopier selon ses indications.
A l’époque j’avais une assez belle écriture, à la plume. J’en ai passé des heures à recopier ces lettres, mais j’avais encore toute l’année suivante à rester dans cette classe de fin d’études, jusqu’aux épreuves du Certificat d’Etudes.
L’année suivante, ce ne fut plus moi qui écrivit ces lettres de remerciements, mais un copain de la classe, Marc Routier, qui avait un bon coup de crayon, dessina plusieurs fois notre école, et la Cathédrale d’Amiens. Ces dessins furent joints à certaines lettres de remerciements, aux généreux donateurs.
mardi 7 avril 2009
Voyage à Compiègne
Dans le courant d’une année scolaire, 1947/1948 ou 1948/1949, ( je ne me souviens pas de la période ) un voyage à Compiègne fut organisé pour les 13/14 ans, filles et garçons en deux cars, sous la direction des enseignants et des membres du Patronage Laïque, qui l’organisait.
Visite de Pierrefonds puis visite du Carrefour de l’Armistice et de la reconstitution du Wagon dans lequel fut signé la fin des combats , le 11 novembre 1918.
Pendant que tous, filles et garçons faisaient le tour de La Clairière de l’Armistice, j’étais chargé de lire, plusieurs fois, la citation gravée sur la grande dalle et de la mémoriser. Pour ensuite la lire à haute voix, sans bafouiller, à toutes et à tous les élèves réunis, autour de la dalle, presque au garde à vous, mais surtout avec recueillement.
- C’est ici que le 11 Novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l’Empire Allemand vaincu par les Peuples Libres qu’il voulait asservir.
A peu de choses près, c’est cela. C’était, il y a, déjà, soixante ans. Souvenir, Souvenir
Pour le repas, le midi, chacun avait apporté son casse-croûte ( œufs durs, pâté, fruits, tomates, etc.) et de la boisson.
Nous avons déjeuné dans une salle de classe d’une école. Et je me souviens, qu’une élève, Arlette Lemoine , qui avait une jolie voix, a poussé la chansonnette en solo.
Puis filles et garçons ont chanté tous ensemble les chansons du programme du Certificat d’Etudes.
L’après-midi, nous avons visité le château Impérial de Compiègne et son Musée de l’Automobile et avant le retour vers Amiens, nous avons continué par une visite au Musée Vivenel sur la place de Compiègne. Il y était présentée une exposition sur Napoléon 1er. et ses conquêtes et un diorama sur la bataille de Waterloo.
Un autre voyage nous fut organisé, pour les garçons seulement, pendant la scolarité 1947/1948, cette fois j’en suis sûr, en train, à Dunkerque, Malo les Bains avec une excursion, toute petite, en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière.
Nous sommes partis en train, le soir, d’Amiens à Arras. Nous avons passé la nuit, assis ou allongé, comme on le pouvait, sur les banquettes de bois des wagons de 3ème classe.
Avec le bruit, la fumée, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, et je fus vasouillard toute la journée. Puis au matin, le train nous emmena à la frontière Belge, où les adultes qui nous accompagnaient, ont acheté du café, du chocolat, des cigarettes, etc. en bonne quantité, alors qu’en France à quelques kilomètres de là, c’était encore la pénurie, les restrictions, avec des rationnements sévères bien que la guerre soit finie depuis deux ans.
Après le retour à Malo les Bains et le casse-croûte sur la plage, nous avons fait un tour au large en voiture amphibie. En guise de jeux sur la plage, j’ai dormi sur celle-ci, au milieu des sacs et des bagages.
Le soir même, retour vers Amiens, mais en un seul trajet. Je l’ai, déjà, écrit, les transports ferroviaires n’étaient pas encore très bien rétablis, organisés, ayant beaucoup souffert de la guerre. Réseaux, gares, ouvrages d’art, nœuds ferroviaires, surtout dans la partie de la France, située au Nord de la Loire et particulièrement tous les départements longeant la Manche, de la Presqu’île du Cotentin, jusqu’à la Frontière Belge.
J’avais une photo de ce voyage, qui fut prise sur la plage de Malo les Bains, mais je l’ai égarée, au cours de mon adolescence mouvementée.
Visite de Pierrefonds puis visite du Carrefour de l’Armistice et de la reconstitution du Wagon dans lequel fut signé la fin des combats , le 11 novembre 1918.
Pendant que tous, filles et garçons faisaient le tour de La Clairière de l’Armistice, j’étais chargé de lire, plusieurs fois, la citation gravée sur la grande dalle et de la mémoriser. Pour ensuite la lire à haute voix, sans bafouiller, à toutes et à tous les élèves réunis, autour de la dalle, presque au garde à vous, mais surtout avec recueillement.
- C’est ici que le 11 Novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l’Empire Allemand vaincu par les Peuples Libres qu’il voulait asservir.
A peu de choses près, c’est cela. C’était, il y a, déjà, soixante ans. Souvenir, Souvenir
Pour le repas, le midi, chacun avait apporté son casse-croûte ( œufs durs, pâté, fruits, tomates, etc.) et de la boisson.
Nous avons déjeuné dans une salle de classe d’une école. Et je me souviens, qu’une élève, Arlette Lemoine , qui avait une jolie voix, a poussé la chansonnette en solo.
Puis filles et garçons ont chanté tous ensemble les chansons du programme du Certificat d’Etudes.
L’après-midi, nous avons visité le château Impérial de Compiègne et son Musée de l’Automobile et avant le retour vers Amiens, nous avons continué par une visite au Musée Vivenel sur la place de Compiègne. Il y était présentée une exposition sur Napoléon 1er. et ses conquêtes et un diorama sur la bataille de Waterloo.
Un autre voyage nous fut organisé, pour les garçons seulement, pendant la scolarité 1947/1948, cette fois j’en suis sûr, en train, à Dunkerque, Malo les Bains avec une excursion, toute petite, en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière.
Nous sommes partis en train, le soir, d’Amiens à Arras. Nous avons passé la nuit, assis ou allongé, comme on le pouvait, sur les banquettes de bois des wagons de 3ème classe.
Avec le bruit, la fumée, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, et je fus vasouillard toute la journée. Puis au matin, le train nous emmena à la frontière Belge, où les adultes qui nous accompagnaient, ont acheté du café, du chocolat, des cigarettes, etc. en bonne quantité, alors qu’en France à quelques kilomètres de là, c’était encore la pénurie, les restrictions, avec des rationnements sévères bien que la guerre soit finie depuis deux ans.
Après le retour à Malo les Bains et le casse-croûte sur la plage, nous avons fait un tour au large en voiture amphibie. En guise de jeux sur la plage, j’ai dormi sur celle-ci, au milieu des sacs et des bagages.
Le soir même, retour vers Amiens, mais en un seul trajet. Je l’ai, déjà, écrit, les transports ferroviaires n’étaient pas encore très bien rétablis, organisés, ayant beaucoup souffert de la guerre. Réseaux, gares, ouvrages d’art, nœuds ferroviaires, surtout dans la partie de la France, située au Nord de la Loire et particulièrement tous les départements longeant la Manche, de la Presqu’île du Cotentin, jusqu’à la Frontière Belge.
J’avais une photo de ce voyage, qui fut prise sur la plage de Malo les Bains, mais je l’ai égarée, au cours de mon adolescence mouvementée.
lundi 6 avril 2009
Retraite catholique
Peu avant la Pentecôte, après la guerre (pendant celle-ci, je ne sais pas) certains jeunes s’absentaient de l’école pour faire une « retraite », dans le patronage catholique, à l’approche de leur communion solennelle, quelques jours après.
Cette retraite permettait, certainement, de se concentrer, de se recueillir, pour mieux se préparer pour cette cérémonie.
Est ce qu’il y avait un Brevet Sportif pendant la guerre ? Je ne le sais pas. Mais en 1946 ou 1947 il y avait bien des épreuves pour ce diplôme.
Pas de stade à Saint Maurice, on avait construit l’Ilot sur celui-ci, pas de plateau de sport à proximité, il fallut faire avec les moyens, rares, disponibles.
Courses à pieds, autour de la cour de l’école.
Il y avait, dans cette cour 3 ou 4 très gros arbres, des acacias ; deux cordes, à nœuds et lisse, y furent accrochées, Par qui ? Donc, entraînement à la montée avec ces deux cordes.
Quant au lancer du poids, cela se faisait dans la cour de l’école. Celle-ci était en terre battue, et même, bien piétinée.
Pour les épreuves sportives, en vue de l’obtention de ce Brevet, il fallait se rendre sur les deux terrains d’Amiens-Sport, situés route d’Albert, juste après le cimetière Saint Pierre rue Paul Pruvot actuellement. Un des deux terrains avait une piste d’athlétisme autour.
Naturellement, aller et retour à pieds. On est sportif ou on ne l’est pas.
De santé, toujours fragile, j’accompagnais les copains, mais je n’avais pas le droit de concourir et pourtant, au mépris des recommandations des médecins, j’ai joué au football à
partir de l’âge de 14 ans et je ne m’en suis pas porté plus mal.
Pas de chaussures de basket comme maintenant : soit des chaussures en toile, dites « de bains de mer » soit des espadrilles à semelles de corde, ou encore des sandales, en toile, cousues avec des semelles en genre de caoutchouc mousse.
Il y avait, bien, un autre terrain de football, près du quartier au carrefour Clemenceau actuel, derrière l’hôpital Nord. Mais c’était juste pour y jouer au football et que cela. Ce stade appartenait au Club Sportif de Saint Leu, un quartier d’Amiens.
A Amiens, il y avait une troisième piscine, de plein air, « La Cheminote » propriété de la
SNCF. Cette piscine, ouverte au public, se situait rue Dejean, face au Pont de la Solitude
L’eau y était très claire, très bien filtrée, sans aucune comparaison possible avec celle
des deux autres piscines municipales. Mais avec le peu de moyens de locomotion de l’époque, peu de vélos ou alors la marche à pieds, c’était, quand même loin de notre quartier, de l’autre côté de la ville, près du Centre d’Apprentissage de la SNCF, dont j’ai parlé plus avant. Par contre, je ne sais pas si les jeunes élèves des quartiers environnants pouvaient s’y rendre par classes entières, comme nous « Au Bain de Sable ».
Pendant la bonne saison, le soir, le week-end ou pendant les vacances, les jeunes pouvaient apprendre à nager, dans le canal de la Somme, à l’écluse de Montières, sous la surveillance des moniteurs du Club Sportif de l’usine Dollé. « La France »
Mais il y avait toujours beaucoup de personnes qui se baignaient dans le canal de la Somme, au Pont Blanc ou au Pont de Fer (pont de la ligne du chemin de fer) plus loin le long du canal. Celui-ci était mieux situé, car on pouvait voir la police arriver de loin, et nous éparpiller, alors, dans la nature.
Cette retraite permettait, certainement, de se concentrer, de se recueillir, pour mieux se préparer pour cette cérémonie.
Est ce qu’il y avait un Brevet Sportif pendant la guerre ? Je ne le sais pas. Mais en 1946 ou 1947 il y avait bien des épreuves pour ce diplôme.
Pas de stade à Saint Maurice, on avait construit l’Ilot sur celui-ci, pas de plateau de sport à proximité, il fallut faire avec les moyens, rares, disponibles.
Courses à pieds, autour de la cour de l’école.
Il y avait, dans cette cour 3 ou 4 très gros arbres, des acacias ; deux cordes, à nœuds et lisse, y furent accrochées, Par qui ? Donc, entraînement à la montée avec ces deux cordes.
Quant au lancer du poids, cela se faisait dans la cour de l’école. Celle-ci était en terre battue, et même, bien piétinée.
Pour les épreuves sportives, en vue de l’obtention de ce Brevet, il fallait se rendre sur les deux terrains d’Amiens-Sport, situés route d’Albert, juste après le cimetière Saint Pierre rue Paul Pruvot actuellement. Un des deux terrains avait une piste d’athlétisme autour.
Naturellement, aller et retour à pieds. On est sportif ou on ne l’est pas.
De santé, toujours fragile, j’accompagnais les copains, mais je n’avais pas le droit de concourir et pourtant, au mépris des recommandations des médecins, j’ai joué au football à
partir de l’âge de 14 ans et je ne m’en suis pas porté plus mal.
Pas de chaussures de basket comme maintenant : soit des chaussures en toile, dites « de bains de mer » soit des espadrilles à semelles de corde, ou encore des sandales, en toile, cousues avec des semelles en genre de caoutchouc mousse.
Il y avait, bien, un autre terrain de football, près du quartier au carrefour Clemenceau actuel, derrière l’hôpital Nord. Mais c’était juste pour y jouer au football et que cela. Ce stade appartenait au Club Sportif de Saint Leu, un quartier d’Amiens.
A Amiens, il y avait une troisième piscine, de plein air, « La Cheminote » propriété de la
SNCF. Cette piscine, ouverte au public, se situait rue Dejean, face au Pont de la Solitude
L’eau y était très claire, très bien filtrée, sans aucune comparaison possible avec celle
des deux autres piscines municipales. Mais avec le peu de moyens de locomotion de l’époque, peu de vélos ou alors la marche à pieds, c’était, quand même loin de notre quartier, de l’autre côté de la ville, près du Centre d’Apprentissage de la SNCF, dont j’ai parlé plus avant. Par contre, je ne sais pas si les jeunes élèves des quartiers environnants pouvaient s’y rendre par classes entières, comme nous « Au Bain de Sable ».
Pendant la bonne saison, le soir, le week-end ou pendant les vacances, les jeunes pouvaient apprendre à nager, dans le canal de la Somme, à l’écluse de Montières, sous la surveillance des moniteurs du Club Sportif de l’usine Dollé. « La France »
Mais il y avait toujours beaucoup de personnes qui se baignaient dans le canal de la Somme, au Pont Blanc ou au Pont de Fer (pont de la ligne du chemin de fer) plus loin le long du canal. Celui-ci était mieux situé, car on pouvait voir la police arriver de loin, et nous éparpiller, alors, dans la nature.
dimanche 5 avril 2009
Un stade fut créé
Un stade fut créé, Chemin des Carmiers ( Chemin de Vauvoix ) sur des terrains cédés par deux agriculteurs de Saint Maurice, Messieurs Lefort et Vatinet.
Auparavant, les poubelles étaient ramassées par des particuliers et déposées dans leurs champs. Ainsi, ces terrains avaient servi de dépôts à ordures ménagères.
Longtemps, il fut fréquenté par les jeunes du coin, il leur fallait, alors, se mettre en ligne et ramasser les morceaux de verre ou les coquillages, qui remontaient à la surface, suite au ruissellement des pluies, surtout, qu’au début, le terrain était légèrement en pente.
C’est ainsi que fut créé, de nouveau, un club de football, je crois en 1947, le club Michelet, comme avant la guerre. De bons copains de l’école primaire firent partie de l’équipe minimes, Pierre Soufflart, Bernard Manca, Paul Dufossé, les Boitel, les Petit, les Louchet, etc.
A la suite de différents problèmes internes, le club Michelet a disparu pour reprendre peu après sous l’appellation de « Club de l’Union Coop ». Puis devint le « Gallia » avant de disparaître de nouveau, des tablettes du football du quartier, pendant quelques temps.
Il revint au grand jour, dans un club recréé, en 1974, par Jean Bernaud et James Lefèvre. Club, toujours en activité, en 2008, sous le nom de « l’Espoir de Saint Maurice ».
Dans ce club, il y a, depuis le début, aussi, il y a une section de hand-ball qui marche très bien.
Aujourd’hui, le terrain est bien nivelé avec une main courante autour et a changé d’aspect..
Dans les temps héroïques, il y avait un vieux wagon désaffecté, pour tout vestiaire. Les joueurs se déshabillaient, se changeaient comme ils pouvaient. Mais plus la plupart des joueurs, habitant près du stade, arrivaient tout équipé et avec un manteau sur les épaules.
J’étais peu doué pour le football, mais j’adorais cela. J’allais jouer à « l’Olympique Amiénois » rue Jean Moulin. C’était le seul club qui fournissait, gratuitement, tout l’équipement, maillot, short, surtout les chaussures, sauf les chaussettes. Pourquoi ?
Ces chaussettes, je les ai tricoté moi même.
Toujours le manque d’argent, la pauvreté ! Car ma mère, couturière à domicile n’avait qu’un petit salaire et mon père, une petite pension d’invalidité.
Je savais tricoter (et je sais toujours le faire) ma mère m’avait appris pendant ma longue convalescence. Mis à part les cours que l’on me donnait, il fallait bien que je m’occupe.
Quand je venais jouer avec mon club, à Saint Maurice, contre mes anciens copains d’école, nous nous déshabillions, dans l’arrière salle d’un bistrot, « Chez Bébert » rue Terral, juste à côté des « Cycles Duquesnoy ». Dans cet ancien Café, il y eut, par la suite, un fleuriste, fermé depuis peu de temps.
Auparavant, les poubelles étaient ramassées par des particuliers et déposées dans leurs champs. Ainsi, ces terrains avaient servi de dépôts à ordures ménagères.
Longtemps, il fut fréquenté par les jeunes du coin, il leur fallait, alors, se mettre en ligne et ramasser les morceaux de verre ou les coquillages, qui remontaient à la surface, suite au ruissellement des pluies, surtout, qu’au début, le terrain était légèrement en pente.
C’est ainsi que fut créé, de nouveau, un club de football, je crois en 1947, le club Michelet, comme avant la guerre. De bons copains de l’école primaire firent partie de l’équipe minimes, Pierre Soufflart, Bernard Manca, Paul Dufossé, les Boitel, les Petit, les Louchet, etc.
A la suite de différents problèmes internes, le club Michelet a disparu pour reprendre peu après sous l’appellation de « Club de l’Union Coop ». Puis devint le « Gallia » avant de disparaître de nouveau, des tablettes du football du quartier, pendant quelques temps.
Il revint au grand jour, dans un club recréé, en 1974, par Jean Bernaud et James Lefèvre. Club, toujours en activité, en 2008, sous le nom de « l’Espoir de Saint Maurice ».
Dans ce club, il y a, depuis le début, aussi, il y a une section de hand-ball qui marche très bien.
Aujourd’hui, le terrain est bien nivelé avec une main courante autour et a changé d’aspect..
Dans les temps héroïques, il y avait un vieux wagon désaffecté, pour tout vestiaire. Les joueurs se déshabillaient, se changeaient comme ils pouvaient. Mais plus la plupart des joueurs, habitant près du stade, arrivaient tout équipé et avec un manteau sur les épaules.
J’étais peu doué pour le football, mais j’adorais cela. J’allais jouer à « l’Olympique Amiénois » rue Jean Moulin. C’était le seul club qui fournissait, gratuitement, tout l’équipement, maillot, short, surtout les chaussures, sauf les chaussettes. Pourquoi ?
Ces chaussettes, je les ai tricoté moi même.
Toujours le manque d’argent, la pauvreté ! Car ma mère, couturière à domicile n’avait qu’un petit salaire et mon père, une petite pension d’invalidité.
Je savais tricoter (et je sais toujours le faire) ma mère m’avait appris pendant ma longue convalescence. Mis à part les cours que l’on me donnait, il fallait bien que je m’occupe.
Quand je venais jouer avec mon club, à Saint Maurice, contre mes anciens copains d’école, nous nous déshabillions, dans l’arrière salle d’un bistrot, « Chez Bébert » rue Terral, juste à côté des « Cycles Duquesnoy ». Dans cet ancien Café, il y eut, par la suite, un fleuriste, fermé depuis peu de temps.
samedi 4 avril 2009
Fin juin 1949
A la fin de juin 1949 nous sommes allés passer les épreuves du Certificat d’Etudes dans une école de Saint Pierre.
Il y avait plusieurs écoles des quartiers périphériques, dont Longpré les Amiens.
Naturellement, départ en groupe de l’école Zamenhoff, à pieds, bien sûr.
Au début des épreuves j’étais un peu angoissé, mais par la suite, je fus plus à l’aise. Il faut bien l’avouer nous n’avions que 14 ans et nous n’étions pas dans notre environnement, dans notre école. On pourrait dire que les élèves de Saint Pierre, pour cela, étaient un peu plus avantagés, étant dans leur milieu. Bien que je connaissais un peu cette angoisse, pour avoir passé des examens pour rentrer dans deux écoles secondaires, SNCF et Ecole Industrielle.
Avec un copain, de toute ma scolarité primaire, Gérard Caillouet, au lieu de revenir chez nous entre 12 et 14 heures, à pieds, pour déjeuner, nous avions pris un casse-croûte et des fruits. Nous sommes allés déjeuner dans un petit bistrot, situé presque en face de l’école, Saint Pierre, tenu par une vieille dame , sympa au possible. Ce bistrot est aujourd’hui disparu.
Après les épreuves classiques, des cours déjà suivis à l’école Saint Maurice, Dictée, calcul, rédaction, interrogations écrites de géographie, d’ histoire, de sciences, de dessin ( un croquis du mécanisme de la balance Roberval, de mémoire, sans modèle ), nous avions les récitations et les chants appris pour la circonstance, je le rappelle, ce n’étaient que des chants patriotiques.
Heureusement, pour moi, les épreuves de chant furent annulées. Ce fut, heureux pour moi, mais aussi, pour les oreilles des examinateurs. Car je chantais et chante, toujours, aussi faux, aussi mal. Pire que n’importe qui !
Quant aux récitations classiques, telles que « Le corbeau et le renard » « Le laboureur et ses enfants » « Le renard et la cigogne » , etc. Nous avions aussi, « La chèvre de Monsieur Séguin » plus de 3 pages.
Par un effet de malchance, c’est celle-ci que j’ai écopé, bien sûr.
Heureusement ce fut très court, les examinateurs écoutaient à peine ce que je tentais de réciter
Enfin cela ne s’est pas trop mal passé.
En fin d’après-midi, attente des résultats dans la cour.
Alors là, séquence émotion, à la lecture des résultats. Reçu ! OUF !
Quel retour à la maison pour annoncer, le bon résultat à mes parents, avant de retourner me coucher, dans ma pension, à proximité.
Nous ne pensions pas, nous ne nous rendions peu compte que c’était un passage dans une autre vie. Que nous allions quitter les copains, bons ou moins bons, chacun prenant un autre chemin, se dirigeant vers un autre destin, un autre horizon. Que c’est bien dit !
Je n’avais, jamais, envisagé en ce moment là, toutes les épreuves que j’allais subir dans les 9 ou 10 années qui allaient suivre.
Il y avait plusieurs écoles des quartiers périphériques, dont Longpré les Amiens.
Naturellement, départ en groupe de l’école Zamenhoff, à pieds, bien sûr.
Au début des épreuves j’étais un peu angoissé, mais par la suite, je fus plus à l’aise. Il faut bien l’avouer nous n’avions que 14 ans et nous n’étions pas dans notre environnement, dans notre école. On pourrait dire que les élèves de Saint Pierre, pour cela, étaient un peu plus avantagés, étant dans leur milieu. Bien que je connaissais un peu cette angoisse, pour avoir passé des examens pour rentrer dans deux écoles secondaires, SNCF et Ecole Industrielle.
Avec un copain, de toute ma scolarité primaire, Gérard Caillouet, au lieu de revenir chez nous entre 12 et 14 heures, à pieds, pour déjeuner, nous avions pris un casse-croûte et des fruits. Nous sommes allés déjeuner dans un petit bistrot, situé presque en face de l’école, Saint Pierre, tenu par une vieille dame , sympa au possible. Ce bistrot est aujourd’hui disparu.
Après les épreuves classiques, des cours déjà suivis à l’école Saint Maurice, Dictée, calcul, rédaction, interrogations écrites de géographie, d’ histoire, de sciences, de dessin ( un croquis du mécanisme de la balance Roberval, de mémoire, sans modèle ), nous avions les récitations et les chants appris pour la circonstance, je le rappelle, ce n’étaient que des chants patriotiques.
Heureusement, pour moi, les épreuves de chant furent annulées. Ce fut, heureux pour moi, mais aussi, pour les oreilles des examinateurs. Car je chantais et chante, toujours, aussi faux, aussi mal. Pire que n’importe qui !
Quant aux récitations classiques, telles que « Le corbeau et le renard » « Le laboureur et ses enfants » « Le renard et la cigogne » , etc. Nous avions aussi, « La chèvre de Monsieur Séguin » plus de 3 pages.
Par un effet de malchance, c’est celle-ci que j’ai écopé, bien sûr.
Heureusement ce fut très court, les examinateurs écoutaient à peine ce que je tentais de réciter
Enfin cela ne s’est pas trop mal passé.
En fin d’après-midi, attente des résultats dans la cour.
Alors là, séquence émotion, à la lecture des résultats. Reçu ! OUF !
Quel retour à la maison pour annoncer, le bon résultat à mes parents, avant de retourner me coucher, dans ma pension, à proximité.
Nous ne pensions pas, nous ne nous rendions peu compte que c’était un passage dans une autre vie. Que nous allions quitter les copains, bons ou moins bons, chacun prenant un autre chemin, se dirigeant vers un autre destin, un autre horizon. Que c’est bien dit !
Je n’avais, jamais, envisagé en ce moment là, toutes les épreuves que j’allais subir dans les 9 ou 10 années qui allaient suivre.
vendredi 3 avril 2009
Après le Certif'
Voyage après le Certificat d’Etudes.
Un voyage fut organisé à Paris pendant trois jours pour récompenser les élèves reçus au Certificat d’Etudes, même ceux qui ne furent pas reçus, y participèrent.
Nous avons visité, dans le désordre, Versailles, une journée, le zoo de Vincennes, les Invalides, l’inévitable Tour Eiffel, etc.
Nous dormions dans un grand dortoir, d’un lycée Parisien. Où ? Je n’en sais rien ! Tout ce dont je me rappelle, c’était près d’un grand canal. Nous ne mangions dans ce lycée que le soir. Le midi, nous déjeunions au hasard de nos visites.
Un soir, nous sommes allés dans un grand cinéma sur les Champs-Elysées. C’était un cinéma permanent, Les séances étaient en boucle, c’était la première fois que nous voyions cela. Le film était « Barry », un chien de secours en montagne, avec Pierre Fresnay.
Autre souvenir, moins bon, pour moi, après un déjeuner au BHV, il y avait, au dessert, un grand bol de moka, pour chacun. Ce fut dur à avaler, j’en avais des hauts de cœur. Les copains ne voulurent pas m’aider à finir ce satané moka. Ils en avaient bien assez de leur bol.
Nous étions tous très fatigués par ces trois jours de visites, à un rythme assez soutenu, mais que de souvenirs.
Un pot, nous fut offert par l’instituteur et son épouse, à leur domicile, au 44 rue de Vignacourt. Nous y avons vu, le fameux escalier sur lequel, parfois, certains punis devaient exécuter, écrire leurs punitions assis sur les marches.
Naturellement, nos familles, par notre intermédiaire, se cotisèrent pour offrir à l’épouse de l’instituteur et à lui même, un cadeau en souvenir ou en reconnaissance.
C’est vraiment là que le groupe s’est disloqué, chacun partant de son côté. De ce groupe de copains par la suite, avec tous les bouleversements, je n’en ai pas revu la moitié.
Cette réception se fit, aussi, les années suivantes.
Un voyage fut organisé à Paris pendant trois jours pour récompenser les élèves reçus au Certificat d’Etudes, même ceux qui ne furent pas reçus, y participèrent.
Nous avons visité, dans le désordre, Versailles, une journée, le zoo de Vincennes, les Invalides, l’inévitable Tour Eiffel, etc.
Nous dormions dans un grand dortoir, d’un lycée Parisien. Où ? Je n’en sais rien ! Tout ce dont je me rappelle, c’était près d’un grand canal. Nous ne mangions dans ce lycée que le soir. Le midi, nous déjeunions au hasard de nos visites.
Un soir, nous sommes allés dans un grand cinéma sur les Champs-Elysées. C’était un cinéma permanent, Les séances étaient en boucle, c’était la première fois que nous voyions cela. Le film était « Barry », un chien de secours en montagne, avec Pierre Fresnay.
Autre souvenir, moins bon, pour moi, après un déjeuner au BHV, il y avait, au dessert, un grand bol de moka, pour chacun. Ce fut dur à avaler, j’en avais des hauts de cœur. Les copains ne voulurent pas m’aider à finir ce satané moka. Ils en avaient bien assez de leur bol.
Nous étions tous très fatigués par ces trois jours de visites, à un rythme assez soutenu, mais que de souvenirs.
Un pot, nous fut offert par l’instituteur et son épouse, à leur domicile, au 44 rue de Vignacourt. Nous y avons vu, le fameux escalier sur lequel, parfois, certains punis devaient exécuter, écrire leurs punitions assis sur les marches.
Naturellement, nos familles, par notre intermédiaire, se cotisèrent pour offrir à l’épouse de l’instituteur et à lui même, un cadeau en souvenir ou en reconnaissance.
C’est vraiment là que le groupe s’est disloqué, chacun partant de son côté. De ce groupe de copains par la suite, avec tous les bouleversements, je n’en ai pas revu la moitié.
Cette réception se fit, aussi, les années suivantes.
jeudi 2 avril 2009
Dernière anecdote
Enfin une dernière et longue anecdote, qui a peu de rapport avec l’école primaire, mais qui eut lieu, quand même, pendant ma scolarité de 1942/43, pendant la guerre.
Ma mère, couturière-confectionneuse, à domicile, travaillait pour les établissements Fusilier, rue Jules Lefebvre, prés du cirque d’Amiens.
Une fois par semaine, à l’aide d’une petite voiturette, à bras, ma mère reportait son travail terminé et en ramenait pour toute la semaine.
C’étaient, presque toujours, des pantalons ou des culottes de cheval, en velours.
Il lui fallait réaliser, construire tout le pantalon, mettre les passants, coudre les agrafes et les boutons, puis repasser les pantalons « à la patte mouille ».
Deux ou trois jours après Noël de 1942, ma mère, reportant son travail terminé, je restais chez des amis de mes parents. Ceux-ci tenaient un café, en bas de la rue de La Falaise.
Ces cafetiers, Monsieur et Madame Flament, à l’époque, avaient environ soixante ans. Elle même était un peu plus âgée que son mari.
J’étais assis, sur la banquette qui longeait tout le mur, à gauche dans le café, et à une table, je faisais mes devoirs. Nous étions, je le rappelle, pendant les vacances de Noël.
Quand soudain, j’ai entendu des voitures s’arrêter, il y en avait peu en ce temps là, puis j’entendis des voix parlant très fort en Français et en Allemand. Il y avait plusieurs personnes en civil et des Allemands en uniforme.
Je les voyais par la fenêtre à côté de moi.
Ils entrèrent dans le café en criant, vociférant et bousculèrent Monsieur et Madame Flament. Cette dernière marchait, difficilement, avec une canne.
Tout ce monde, se mit à chercher. Quoi ? Ils vidaient tous les tiroirs, les placards, etc.
Je pris peur, repliais mes cahiers et mes livres de classe, casais le tout sur la banquette dans le coin de la salle et je me sauvais, à toutes jambes, en remontant la rue de La Falaise.
Je revois, encore, l’officier Allemand, très grand, une chaîne autour du cou, avec une plaque. Il criait, gesticulait pour, certainement, que je revienne, plus il criait, plus je me sauvais.
S’il avait bien voulu courir après moi, il m’aurait certainement rattrapé. Je n’allais avoir que huit ans, seulement.
J’allais chez des commerçants de la rue Saint Maurice. Ils vendaient du poisson, quand il y en avait ou des légumes ou des fruits selon les difficiles possibilités de ravitaillement.
Ces commerçants, Monsieur et Madame Rassineux me conseillèrent de rentrer chez moi, pour attendre le retour de ma mère. En effet, j’avais des clefs pour rentrer à la maison.
Je fis demi-tour, sans passer par la rue de La Falaise, au travers de l’îlot Saint Maurice en construction sur l’ancienne place et sur l’ancien stade de Saint Maurice.
J’arrivais à hauteur de notre maison, quand je vis, soudain, par dessus les jardins ouvriers, en contre-bas, à l’époque il n’y avait pas de haies, les voitures Allemandes qui ralentissaient et, peut être, s’arrêtaient devant chez moi.
J’avais une peur bleue, j’étais paniqué.
Je continuais sur ma lancée à courir et un peu plus loin, il y avait de grands arbres et des taillis, dans lesquels je me planquais, pour regarder vers notre maison.
Ce n’était pas pour chez nous, mais chez nos voisins.
Les Allemands y passèrent un long moment pour fouiller la maison et repartirent, enfin !
Ma mère, couturière-confectionneuse, à domicile, travaillait pour les établissements Fusilier, rue Jules Lefebvre, prés du cirque d’Amiens.
Une fois par semaine, à l’aide d’une petite voiturette, à bras, ma mère reportait son travail terminé et en ramenait pour toute la semaine.
C’étaient, presque toujours, des pantalons ou des culottes de cheval, en velours.
Il lui fallait réaliser, construire tout le pantalon, mettre les passants, coudre les agrafes et les boutons, puis repasser les pantalons « à la patte mouille ».
Deux ou trois jours après Noël de 1942, ma mère, reportant son travail terminé, je restais chez des amis de mes parents. Ceux-ci tenaient un café, en bas de la rue de La Falaise.
Ces cafetiers, Monsieur et Madame Flament, à l’époque, avaient environ soixante ans. Elle même était un peu plus âgée que son mari.
J’étais assis, sur la banquette qui longeait tout le mur, à gauche dans le café, et à une table, je faisais mes devoirs. Nous étions, je le rappelle, pendant les vacances de Noël.
Quand soudain, j’ai entendu des voitures s’arrêter, il y en avait peu en ce temps là, puis j’entendis des voix parlant très fort en Français et en Allemand. Il y avait plusieurs personnes en civil et des Allemands en uniforme.
Je les voyais par la fenêtre à côté de moi.
Ils entrèrent dans le café en criant, vociférant et bousculèrent Monsieur et Madame Flament. Cette dernière marchait, difficilement, avec une canne.
Tout ce monde, se mit à chercher. Quoi ? Ils vidaient tous les tiroirs, les placards, etc.
Je pris peur, repliais mes cahiers et mes livres de classe, casais le tout sur la banquette dans le coin de la salle et je me sauvais, à toutes jambes, en remontant la rue de La Falaise.
Je revois, encore, l’officier Allemand, très grand, une chaîne autour du cou, avec une plaque. Il criait, gesticulait pour, certainement, que je revienne, plus il criait, plus je me sauvais.
S’il avait bien voulu courir après moi, il m’aurait certainement rattrapé. Je n’allais avoir que huit ans, seulement.
J’allais chez des commerçants de la rue Saint Maurice. Ils vendaient du poisson, quand il y en avait ou des légumes ou des fruits selon les difficiles possibilités de ravitaillement.
Ces commerçants, Monsieur et Madame Rassineux me conseillèrent de rentrer chez moi, pour attendre le retour de ma mère. En effet, j’avais des clefs pour rentrer à la maison.
Je fis demi-tour, sans passer par la rue de La Falaise, au travers de l’îlot Saint Maurice en construction sur l’ancienne place et sur l’ancien stade de Saint Maurice.
J’arrivais à hauteur de notre maison, quand je vis, soudain, par dessus les jardins ouvriers, en contre-bas, à l’époque il n’y avait pas de haies, les voitures Allemandes qui ralentissaient et, peut être, s’arrêtaient devant chez moi.
J’avais une peur bleue, j’étais paniqué.
Je continuais sur ma lancée à courir et un peu plus loin, il y avait de grands arbres et des taillis, dans lesquels je me planquais, pour regarder vers notre maison.
Ce n’était pas pour chez nous, mais chez nos voisins.
Les Allemands y passèrent un long moment pour fouiller la maison et repartirent, enfin !
J’étais frigorifié
J’étais frigorifié, gelé mais je pus rentrer chez moi et ma mère arriva peu après.
Je me rappelle avoir pris une fessée et une engueulade mémorable, méritées, pour m’être sauvé et avec la peur rétrospective de ma mère.
Je repartis avec ma mère pour remettre de l’ordre, chez ce vieux couple. Quel déballage ! Quel fouillis !
Peu de jours avant, le soir de Noël, des résistants avaient fait exploser une bombe, contre les fenêtres d’un bar- restaurant-dancing, « Le Royal » situé à l’emplacement actuel du magasin de chaussures « André » rue des 3 Cailloux.
Ce restaurant-dancing servait , beaucoup, aux officiers Allemands pour se distraire.
Suite à cet attentat, les services de police, Français et Allemands, recherchaient les auteurs de cet attentat et des listes de résistants ou des indices pour les identifier.
Ma voisine, Simone Laurent, son neveu Louis Bixel, et une autre personne, un homme surnommé « Bouboule » travaillaient au « Royal » et furent, avec d’autres personnes arrêtées et emprisonnées à la prison d’Amiens.
Après enquête, ils furent tous relâchés au bout de 48 heures.
Selon les dires des FTP, il y aurait eu 35 morts
Les Allemands avaient proclamé :
S’il y a un mort Allemand, nous fusillerons 10 otages Français.
Et il n’y eut pas d’otage fusillé car il n’y eut aucun officier Allemand tué, dans l’explosion. Seules des « souris grises », auxiliaires féminines Allemandes, se maquillant au sous-sol, furent légèrement blessées.
C’est ainsi que l’on falsifie l’Histoire !
Tels, les 75.000 fusillés, déplorés par le Parti Communiste, pendant toute la guerre , alors que cela est prouvé et démontré par les historiens que les Allemands fusillèrent, environ, 26.000 personnes en France. Il y eut, à Amiens, 37 fusillés, environ, à la Citadelle.
Mon voisin, Georges Laurent, un dur, avait fait toute la guerre 1914/1918, dans les Corps Francs. Il avait accroché, au dessus de sa cheminée, le tableau représentant les plénipotentiaires, Anglais, Allemands, Français, lors de la Signature de l’Armistice dans le Wagon à Rethondes prés de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Au cours de la perquisition chez ce voisin, le même, grand officier Allemand du bistrot, est resté planté devant le tableau, et ne fit aucun commentaire. Il repartit sans avoir touché à ce tableau commémoratif.
C’est à la suite d’une dénonciation, fausse évidemment, d’un « collabo » du quartier, que ces perquisitions eurent lieu et sans aucun résultat.
Le « collabo » habitait dans une remorque de nomade, près du cimetière de La Madeleine. Lui même et son épouse furent fusillés juste après la Libération, au début du mois de septembre 1944.
A l’origine, le café-bistrot était situé sur le coin opposé, en face, à droite, mais il fut démoli en 1940, et ne fut reconstruit que vers les années 1955 ou 1956.
En attendant sa reconstruction, le commerce fut aménagé dans un baraquement provisoire construit en 1941 sur le coin de la rue, en face. Baraquement, provisoire, qui existe toujours en 2008.
Je me rappelle avoir pris une fessée et une engueulade mémorable, méritées, pour m’être sauvé et avec la peur rétrospective de ma mère.
Je repartis avec ma mère pour remettre de l’ordre, chez ce vieux couple. Quel déballage ! Quel fouillis !
Peu de jours avant, le soir de Noël, des résistants avaient fait exploser une bombe, contre les fenêtres d’un bar- restaurant-dancing, « Le Royal » situé à l’emplacement actuel du magasin de chaussures « André » rue des 3 Cailloux.
Ce restaurant-dancing servait , beaucoup, aux officiers Allemands pour se distraire.
Suite à cet attentat, les services de police, Français et Allemands, recherchaient les auteurs de cet attentat et des listes de résistants ou des indices pour les identifier.
Ma voisine, Simone Laurent, son neveu Louis Bixel, et une autre personne, un homme surnommé « Bouboule » travaillaient au « Royal » et furent, avec d’autres personnes arrêtées et emprisonnées à la prison d’Amiens.
Après enquête, ils furent tous relâchés au bout de 48 heures.
Selon les dires des FTP, il y aurait eu 35 morts
Les Allemands avaient proclamé :
S’il y a un mort Allemand, nous fusillerons 10 otages Français.
Et il n’y eut pas d’otage fusillé car il n’y eut aucun officier Allemand tué, dans l’explosion. Seules des « souris grises », auxiliaires féminines Allemandes, se maquillant au sous-sol, furent légèrement blessées.
C’est ainsi que l’on falsifie l’Histoire !
Tels, les 75.000 fusillés, déplorés par le Parti Communiste, pendant toute la guerre , alors que cela est prouvé et démontré par les historiens que les Allemands fusillèrent, environ, 26.000 personnes en France. Il y eut, à Amiens, 37 fusillés, environ, à la Citadelle.
Mon voisin, Georges Laurent, un dur, avait fait toute la guerre 1914/1918, dans les Corps Francs. Il avait accroché, au dessus de sa cheminée, le tableau représentant les plénipotentiaires, Anglais, Allemands, Français, lors de la Signature de l’Armistice dans le Wagon à Rethondes prés de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Au cours de la perquisition chez ce voisin, le même, grand officier Allemand du bistrot, est resté planté devant le tableau, et ne fit aucun commentaire. Il repartit sans avoir touché à ce tableau commémoratif.
C’est à la suite d’une dénonciation, fausse évidemment, d’un « collabo » du quartier, que ces perquisitions eurent lieu et sans aucun résultat.
Le « collabo » habitait dans une remorque de nomade, près du cimetière de La Madeleine. Lui même et son épouse furent fusillés juste après la Libération, au début du mois de septembre 1944.
A l’origine, le café-bistrot était situé sur le coin opposé, en face, à droite, mais il fut démoli en 1940, et ne fut reconstruit que vers les années 1955 ou 1956.
En attendant sa reconstruction, le commerce fut aménagé dans un baraquement provisoire construit en 1941 sur le coin de la rue, en face. Baraquement, provisoire, qui existe toujours en 2008.
mercredi 1 avril 2009
Mes souvenirs
Voici, donc, mes souvenirs d’école primaire de 1939 à 1949, tels que je les ai vécu sans fioriture, mais très exacts.
Ces souvenirs sont des faits réels, vécus, supportés difficilement parfois. Ce ne sont pas des faits que l’on nous raconte et dont vous êtes persuadés que vous les avez vécus.
Certes, je fais toujours et encore des fautes de Français, je m’en excuse. J’ai quitté l’école primaire, au Certificat d’Etudes, il y a, maintenant, 60 ans. Et je me targuais, pourtant, d’avoir une assez bonne mémoire. Mais on ne retient bien que ce que l’on aime.
Il faut bien l’avouer, malgré des souvenirs pas toujours agréables, c’était, quand même le bon temps, sans penser au lendemain. Même si la vie était dure.
Temps d’insouciance, sans aucun souci pour l’avenir. Sans penser aux responsabilités qui incombent aux parents, aux adultes, travail, santé, famille, enfants.
Nous étions bien formés à l’école primaire avec de bonnes bases dans les matières principales nécessaires dans la vie, Français, calcul, géométrie, etc.
Bien sûr, maintenant, il y a les calculettes, qui remplacent, avantageusement, les bonnes vieilles règles à calculer à curseur.
Il y a, aussi, les ordinateurs, qui signalent les fautes de Français, mais qui, hélas, ne servent pas, seulement, à étudier, mais également à s’amuser avec les jeux vidéo.
Certes, la suite des événements ont bouleversé ma vie et celle-ci ne m’a pas souri, ne fut pas tendre avec moi, pendant huit ans après ma sortie de l’école primaire, mais ce sont les aléas de la vie.
Tout cela sont des faits marquants de ma vie, de mon adolescence, de ma jeunesse Cela m’a fait du bien de me rappeler tous ces souvenirs, de les écrire et de dire ou de signaler aux jeunes de cette nouvelle époque, qu’ils ne sont pas, et de loin, aussi malheureux que nous.
Qu’ils ont la grande chance de pouvoir étudier dans des conditions bien meilleures que les nôtres et qu’ils diront, plus tard, en pensant à l’école primaire, ou peut être même au collège en secondaire, que c’était quand même :
« Le Bon Temps »
Ces souvenirs sont des faits réels, vécus, supportés difficilement parfois. Ce ne sont pas des faits que l’on nous raconte et dont vous êtes persuadés que vous les avez vécus.
Certes, je fais toujours et encore des fautes de Français, je m’en excuse. J’ai quitté l’école primaire, au Certificat d’Etudes, il y a, maintenant, 60 ans. Et je me targuais, pourtant, d’avoir une assez bonne mémoire. Mais on ne retient bien que ce que l’on aime.
Il faut bien l’avouer, malgré des souvenirs pas toujours agréables, c’était, quand même le bon temps, sans penser au lendemain. Même si la vie était dure.
Temps d’insouciance, sans aucun souci pour l’avenir. Sans penser aux responsabilités qui incombent aux parents, aux adultes, travail, santé, famille, enfants.
Nous étions bien formés à l’école primaire avec de bonnes bases dans les matières principales nécessaires dans la vie, Français, calcul, géométrie, etc.
Bien sûr, maintenant, il y a les calculettes, qui remplacent, avantageusement, les bonnes vieilles règles à calculer à curseur.
Il y a, aussi, les ordinateurs, qui signalent les fautes de Français, mais qui, hélas, ne servent pas, seulement, à étudier, mais également à s’amuser avec les jeux vidéo.
Certes, la suite des événements ont bouleversé ma vie et celle-ci ne m’a pas souri, ne fut pas tendre avec moi, pendant huit ans après ma sortie de l’école primaire, mais ce sont les aléas de la vie.
Tout cela sont des faits marquants de ma vie, de mon adolescence, de ma jeunesse Cela m’a fait du bien de me rappeler tous ces souvenirs, de les écrire et de dire ou de signaler aux jeunes de cette nouvelle époque, qu’ils ne sont pas, et de loin, aussi malheureux que nous.
Qu’ils ont la grande chance de pouvoir étudier dans des conditions bien meilleures que les nôtres et qu’ils diront, plus tard, en pensant à l’école primaire, ou peut être même au collège en secondaire, que c’était quand même :
« Le Bon Temps »
Inscription à :
Articles (Atom)